Une floraison monastique inattendue
Fondée à Diou, dans l’Allier, en 1132, l’abbaye de Sept-Fons produit aujourd’hui encore des fruits à travers
le monde. Tour d’horizon d’un modèle de réussite fragile qui repose sur la confiance en Dieu.
 Abbaye de Sept-Fons / © DR
Abbaye de Sept-Fons / © DR
Dans l’est du Sénégal, en 2017, un groupe d’hommes débarque en pleine brousse. Rien, sinon la grâce de Dieu, ne laissait présager qu’en 2025 ils seraient encore là. Au village voisin, les gens n’auraient pas parié que les inconnus s’obstineraient. « Ils se disaient : "C’est qui, ces types-là ?" » confie frère Baudouin. Dans cette région musulmane, la population ignore les chrétiens qui ont mauvaise réputation et ne prête pas plus attention aux moines, dont les prières et le dépouillement ne sauraient cohabiter avec l’image qu’on se fait de l’Occident. Ce sont des trappistes, cisterciens de la stricte observance, qui viennent d’arriver à Badi. « L’aventure, pour stimulante qu’elle soit, confie frère Baudouin, est harassante. »
UN ALLER-RETOUR PRODIGIEUX
Pourquoi une Trappe ici ? Tout a commencé avec Dom Charles, membre de la minorité catholique sénégalaise (5 %) qui, adolescent, avait la certitude que Dieu l’appelait à la vie contemplative. Après un passage à l’abbaye bénédictine de Keur Moussa, il est orienté vers les cisterciens du pays qui ont des liens avec une abbaye trappiste du Bourbonnais, Notre-Dame de Sept-Fons. Voilà comment le jeune homme arrive dans l’Allier en 2007. Les façons de la vieille maison, qui fêtera son neuvième centenaire en 2032, l’adaptation au monde moderne et la fidélité aux traditions de la vie contemplative le séduisent ; il est heureux de cette existence exigeante. Puis l’affluence de Sénégalais l’amène à s’interroger : faut-il fonder au Sénégal ? En terre d’islam, quand la poussée djihadiste préoccupe, Dom Charles écarte les inquiétudes, évoque l’histoire du pays, ses confréries qui parent aux dérives violentes, étrangères aux mentalités sénégalaises. Le danger, possible – « il n’y a pas de risque zéro » – est moins grand qu’en France et viendrait de jeunes excités par des imams d’Internet mais, la surveillance familiale étant plus stricte qu’en Europe, cela ne fait pas peur.
L’on prospecte. L’évêché de Tambakounda est réceptif, les autorités civiles aussi. Badi ? Vastes terrains disponibles dans un méandre de la Gambie, eau potable abondante, paysages splendides près d’un parc national. Comme le dit frère Baudouin, « c’est un enchantement de voir le jour se lever sur la brousse survolée par des oiseaux multicolores dont les chants emplissent l’espace ». Les défauts : isolement, à sept heures de route de la capitale et à soixante kilomètres de la ville la plus proche, une éreintante perte de temps. Le fleuve a des crues dévastatrices. Le pire ? « La chaleur, terrible, même pour les Sénégalais… La température est ordinairement de 45 °C et la nuit ne descend pas en dessous de 30 °C. » Les frères feront avec. Sans nier l’épuisement. Il faudra se protéger de la fournaise, climatiser les dortoirs car, faute de sommeil, les moines ne pourraient ni prier ni travailler. Arrivé en 2023, frère Baudouin s’est adapté à la précarité et aux températures. Lui, qui travaillait en plein air, savoure les grands espaces africains, la nature, « à matines le ciel constellé qui parle de Dieu ». La rudesse, l’inconfort des commencements sont un moyen pour « se recentrer sur l’essentiel et ne pas se disperser ».
Pour les moines, sénégalais, français, burkinabé, mexicain, mauricien, « la joie est de transposer le modèle monastique » dans ce pays non chrétien. L’évangélisation n’étant pas leur vocation, ils se bornent à être là, présents au Christ, accueillants. Un jour, l’abbaye pourra recevoir des hôtes, des retraitants. Certes, les voisins restent sur leur quant-à-soi, mais l’embauche de main d’oeuvre a resserré les liens. La communauté vit de maraîchage – cultures européennes et produits locaux : « gombos, aubergines amères, piments… », énumère frère Baudouin, « et des plantes médicinales pour la confection de baumes », ajoute Dom Charles. Mais si l’abbaye veut son indépendance financière et se développer, cela ne suffira pas. Dom Charles rêve de produire de l’eau minérale inexistante dans la région, car le fleuve alimente des sources pures : inestimable en ce pays torride ! Des études ont prouvé la viabilité de l’entreprise, mais il faut des installations considérables, des contrôles de qualité, une chaîne d’embouteillage, un circuit de distribution. Cela coûtera mais libérera des soucis matériels et développera l’économie locale : « Cela favorisera le vivre ensemble en créant des liens justes. »
DU SÉNÉGAL AU MOYEN-ORIENT
En Israël, il ne s’agit pas de fonder – la chose est faite depuis octobre 1890 – mais de réveiller l’abbaye de Latroun, près d’Emmaüs. Pour Dom Patrick, cette décision de Sept-Fons d’assurer la relève est une évidence : « Impensable de laisser disparaître les trappistes de Terre Sainte ! » Ici, rien n’a jamais été simple : la présence du monastère ennuie, car il occupe une position stratégique entre Jaffa et Jérusalem, et beaucoup estiment que ces terres seraient plus utiles entre leurs mains. Au fil des conflits de Terre sainte, Latroun a su malgré tout demeurer fidèle à sa vocation de havre de paix. Arrivé jeune profès à la fin 2023, frère Athanase commente : « La vie à Latroun prouve que paix et concorde entre peuples d’origines et confessions différentes est possible. Ici, Israéliens et Palestiniens s’entendent, alors que cela est ailleurs très difficile. Peut-être est-ce la mission des chrétiens : montrer que la paix du Christ est une réalité concrète au quotidien. Latroun demeure ce qu’un monastère doit être : un lieu inscrit dans une géographie mais hors du monde, avec une organisation capable d’offrir un cadre de prière, louange, intercession. » Si on lui demande comment il vit la transplantation de son abbaye française dans un pays en guerre, frère Athanase y voit une grâce « qui oblige à donner le meilleur de soi et continuer à dire oui, s’efforcer de répondre de son mieux à l’appel reçu ». Dom Patrick, quant à lui, évoque les missiles qui, malgré le Dôme de fer israélien, survolent le monastère « mais n’y tombent pas ! » Seuls les trappistes ne se plaignent pas des alertes nocturnes dont les sirènes retentissent après la cloche de matines.
Comptant vingt moines, l’abbaye est un « espace de vie chrétienne dans un contexte difficile qui donne la priorité à la relation avec Dieu et la possibilité de passer du temps avec lui ». Frère Athanase insiste : « Nous ne partons pas de zéro. Latroun a un passé, des frères qui en sont témoins avec lesquels les derniers arrivés doivent composer. C’est la vie monastique qui se poursuit. Correctement menée, elle attirera de nouveaux moines qui prendront la relève et la poursuivront en y intégrant des éléments de leur époque. » Dom Patrick évoque la particularité de Latroun de n’avoir presque pas accueilli de vocations locales, même quand elle s’était dotée d’un juvénat ; son maintien a toujours réclamé des moines d’Europe. Ils sont actuellement neuf Français de Sept-Fons. La maison mère, avec ses 80 frères, peut se le permettre. « Une mère n’abandonne pas ses enfants, même quand ceux-ci ont grandi. Il s’agit de donner un coup de jeune », analyse Dom Patrick. Confrontée à trop de difficultés, l’abbaye de Latroun n’a pas eu loisir d’entreprendre des travaux de restauration et de mise aux normes. Depuis 2020, le cellérier, père Aloïs, a repris en main les 16 hectares de vigne et les 140 hectares d’oliveraie, soutenu par la Fondation des monastères et les Chevaliers du Saint-Sépulcre. Une aide d’autant plus nécessaire que l’autre activité, l’accueil des pèlerins, est, en raison de la guerre, à l’arrêt. Les frères font contre mauvaise fortune bon coeur : « Nous profitons de ce moment creux pour refaire l’hôtellerie et en améliorer l’accessibilité. Des chantiers de consolidation des bâtiments devraient suivre, si les finances le permettent… »
Ce futur incertain ne préoccupe pas les frères qui ont des projets : vente à l’étranger de l’huile et des vins de l’abbaye, attente des touristes et pèlerins qui, la paix revenue, apprécieront, dans une hôtellerie modernisée, de poser leur sac à Latroun et de rayonner à travers la Terre sainte. Mais ils font d’abord confiance à la Providence. « Si Dieu veut des moines à Latroun, la communauté se développera. Il ne s’agit pas de fatalisme et de laisser Dieu se charger de nous, mais de saine passivité. C’est lui qui mène la barque, mais il nous donne des rames. À nous de faire le travail ! Si les moines se mobilisent dans l’unique but de développer une relation d’amitié avec Dieu, alors il fera ce à quoi nous n’arriverions jamais : fructifier la vie chrétienne dans un contexte défavorable. Pour cela, la messe quotidienne est le phare de notre vie », commente frère Athanase. Si l’on évoque les insultes taguées par des juifs ultra orthodoxes, l’incendie de la porte de l’église, incidents largement blâmés car les moines sont appréciés pour leur présence « aussi discrète que nécessaire », les frères répondent : « Vivre en Terre sainte est une joie, c’est également une épreuve. »
LES BERNARDINES DE L’ABBAYE DE CHAMBARAND
Pour finir, nous pourrions évoquer la fondation d’une fille de Sept-Fons au Vietnam, à l’étude depuis quelques années, l’aide à la Trappe provençale d’Aiguebelle et à une autre en Belgique, mais parlons plutôt de la renaissance des Bernardines et de l’abbaye de Chambarand où elles se sont installées. Tout commence en 2004 avec la visite à Sept- Fons d’une jeune pharmacienne venue de Suisse, enthousiasmée par les écrits de son compatriote, le père Jérôme, et désireuse de mener une vie monastique comme il l’enseignait. Mais une communauté masculine ne reçoit pas de femmes. Mère Bénédicte, supérieure de Chambarand, se souvient de cette rencontre : « Bien que surpris, les frères furent très gentils » et la renvoyèrent aux cisterciennes. Les moines admettent en souriant n’avoir pas bien mesuré le sérieux ni l’entêtement de la solliciteuse et de ses compagnes, françaises ou venues d’Extrême-Orient. Toutes avaient une idée très précise de la vie monastique dont elles rêvaient. Mère Bénédicte évoque les maisons contemplatives visitées, mais nulle part elle ne trouvait ce à quoi elle aspirait.
Ces déconvenues l’ont conduite à un projet fou, elle l’admet : « Puisque ce que je cherchais n’existait pas, je me suis dit : je le ferai moimême ! » Elle est revenue à Sept-Fons demander de l’aide. Toujours surpris, embarrassés mais touchés, les frères, avec l’espoir de les décourager, ont mis la vocation de ces jeunes femmes à l’épreuve, imposant aux unes une formation en philosophie, aux autres des cours de français, pensant que cette période de trois ans les dissuaderait. Il n’en fut rien ! Et, face à une dizaine de postulantes qui avaient fait leurs preuves, assez nombreuses pour fonder une communauté et déterminées, les supérieurs commencèrent à envisager l’avenir. L’évêque de Moulins disposait de bâtiments vides. Il y logea le groupe temporairement, confiant sur le fait que si l’idée ne venait pas de Dieu, elle péricliterait. C’était en 2011. En 2016, son successeur les dota de statuts et les reconnut association publique de fidèles ad experimentum. Sept-Fons joua le jeu. Sa maison de Chambarand, en Isère, était vide. On y installa celles que l’on avait baptisées « Bernardines », branche féminine cistercienne disparue de France, pour les différencier des « Trappistines », dont elles ne portent pas l’habit. La greffe a pris. Manquent les fonds pour la réfection et l’aménagement des bâtiments de 1868, dont l’hôtellerie. En attendant, les soeurs vivent de la fabrication de cosmétiques et friandises. Là aussi, la confiance est à l’ordre du jour.
Devant l’ampleur de tous ces projets fabuleux, le jeune frère Athanase répond en citant Bloy : « Faire confiance obtient ce que l’on n’aurait jamais cru possible. » Quant au père abbé, Dom Thomas, interrogé sur l’étonnante survie de Sept-Fons qui, à neuf cents ans, essaime, il répond : « Fidélité de Dieu. » C’est vrai, et il a fallu qu’y réponde… celle des hommes.
Anne Bernet
Retour à l'accueil

La puissance du sacerdoce
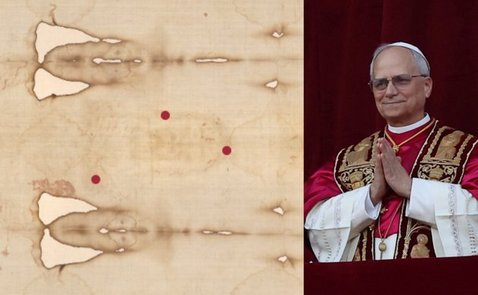
La soif de croire des jeunes ! Conférence de MGR François Bustillo
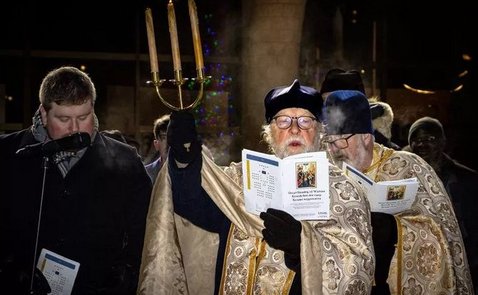
Canada. Messe de l’Épiphanie au musée
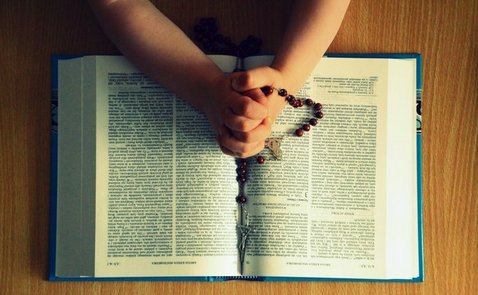
Il enregistre la Bible pour ses petits-enfants

Chrétiens et iraniens, deux fois menacés

Léon XIV livre sa vision du monde au corps diplomatique

Signes ou canards ?
Le pardon est-il toujours possible ? Ces…Le mal, Dieu et la raison : l'analyse d'Olivier Bonnassies


 _Tribune Chrétienne,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
Conversions
 _Tribune Chrétienne,
Portrait,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
Portrait,
Conversions
 _Tribune Chrétienne,
Portrait,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
Portrait,
Conversions
 _Tribune Chrétienne,
Témoignages,
Guérisons
_Tribune Chrétienne,
Témoignages,
Guérisons
 _Tribune Chrétienne,
Miracles,
Guérisons
_Tribune Chrétienne,
Miracles,
Guérisons
 Actualité en bref,
Portrait,
Guérisons
Actualité en bref,
Portrait,
Guérisons
 A la une,
Témoignages,
Histoires providentielles
A la une,
Témoignages,
Histoires providentielles
 A la une,
Histoires providentielles
A la une,
Histoires providentielles
 A la une,
Société,
Histoires providentielles
A la une,
Société,
Histoires providentielles
 A la une,
Ils ont vu la vierge
A la une,
Ils ont vu la vierge
 A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Ils ont vu la vierge
A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Ils ont vu la vierge
 _Tribune Chrétienne,
Ils ont vu la vierge
_Tribune Chrétienne,
Ils ont vu la vierge
 A la une,
Éditoriaux,
Religion
A la une,
Éditoriaux,
Religion
 A la une,
Sortir,
Grands reportages
A la une,
Sortir,
Grands reportages
 _Tribune Chrétienne,
Sortir,
Patrimoine
_Tribune Chrétienne,
Sortir,
Patrimoine
 A la une,
Sortir
A la une,
Sortir
 _Tribune Chrétienne,
Patrimoine,
Littérature
_Tribune Chrétienne,
Patrimoine,
Littérature
 A la une,
Patrimoine
A la une,
Patrimoine
 Actualité en bref,
Patrimoine
Actualité en bref,
Patrimoine
 Actualité en bref,
Écritures
Actualité en bref,
Écritures
 A la une,
Histoire,
Écritures
A la une,
Histoire,
Écritures
 A la une,
Histoire,
Écritures
A la une,
Histoire,
Écritures
 Actualité en bref,
Églises
Actualité en bref,
Églises
 _TopNL,
Actualité en bref,
Églises
_TopNL,
Actualité en bref,
Églises
 _Tribune Chrétienne,
Églises
_Tribune Chrétienne,
Églises
 A la une,
Patrimoine,
Grands reportages,
Histoires providentielles
A la une,
Patrimoine,
Grands reportages,
Histoires providentielles
 A la une,
Grands reportages,
Ils ont vu la vierge
A la une,
Grands reportages,
Ils ont vu la vierge
 _Tribune Chrétienne,
Le saint du jour
_Tribune Chrétienne,
Le saint du jour
 _TopNL,
Actualité en bref,
Le saint du jour
_TopNL,
Actualité en bref,
Le saint du jour
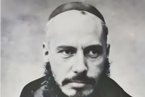 A la une,
Le saint du jour
A la une,
Le saint du jour
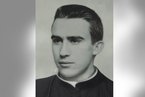 _Tribune Chrétienne,
Miracles
_Tribune Chrétienne,
Miracles
 _TopNL,
Actualité en bref,
Le saint du jour,
Miracles
_TopNL,
Actualité en bref,
Le saint du jour,
Miracles
 _Tribune Chrétienne,
Débats
_Tribune Chrétienne,
Débats
 Actualité en bref,
Société
Actualité en bref,
Société
 Actualité en bref,
Société
Actualité en bref,
Société
 Actualité en bref,
Société
Actualité en bref,
Société
 _Tribune Chrétienne,
Critiques,
Débats
_Tribune Chrétienne,
Critiques,
Débats
 _TopNL,
Actualité en bref,
Sortir,
Critiques
_TopNL,
Actualité en bref,
Sortir,
Critiques
 _Tribune Chrétienne,
Sciences,
Critiques,
Débats,
Miracles
_Tribune Chrétienne,
Sciences,
Critiques,
Débats,
Miracles
 A la une,
Éditoriaux,
Le saint du jour
A la une,
Éditoriaux,
Le saint du jour
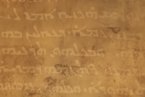 A la une,
Éditoriaux,
Écritures
A la une,
Éditoriaux,
Écritures
 A la une,
Grands entretiens,
Témoignages
A la une,
Grands entretiens,
Témoignages
 A la une,
Patrimoine,
Grands entretiens,
Églises
A la une,
Patrimoine,
Grands entretiens,
Églises
 Vidéo
Vidéo
 Vidéo
Vidéo
 Vidéo
Vidéo
 Actualité en bref,
Environnement
Actualité en bref,
Environnement
 A la une,
Environnement,
Méditation
A la une,
Environnement,
Méditation
 Actualité en bref,
Histoire
Actualité en bref,
Histoire
 _Tribune Chrétienne,
Histoire
_Tribune Chrétienne,
Histoire
 _TopNL,
Actualité en bref,
Médecine et bioéthique
_TopNL,
Actualité en bref,
Médecine et bioéthique
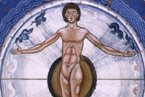 A la une,
Médecine et bioéthique,
Guérisons
A la une,
Médecine et bioéthique,
Guérisons
 _Tribune Chrétienne,
Médecine et bioéthique,
Patrimoine,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
Médecine et bioéthique,
Patrimoine,
Conversions
 A la une,
Méditation
A la une,
Méditation
 A la une,
Méditation
A la une,
Méditation
 A la une,
Méditation,
Témoignages
A la une,
Méditation,
Témoignages
 _TopNL,
Actualité en bref,
Sciences
_TopNL,
Actualité en bref,
Sciences
 _Tribune Chrétienne,
Société,
Sciences,
Églises
_Tribune Chrétienne,
Société,
Sciences,
Églises
 Actualité en bref,
Technologies
Actualité en bref,
Technologies
 _Tribune Chrétienne,
Technologies
_Tribune Chrétienne,
Technologies
 _Tribune Chrétienne,
L'habit ne fait pas le moine,
Portrait,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
L'habit ne fait pas le moine,
Portrait,
Conversions
 A la une,
L'habit ne fait pas le moine
A la une,
L'habit ne fait pas le moine
 A la une,
Les 5 raisons de croire de...
A la une,
Les 5 raisons de croire de...
 A la une,
Les 5 raisons de croire de...
A la une,
Les 5 raisons de croire de...
 A la une,
Les 5 raisons de croire de...
A la une,
Les 5 raisons de croire de...
 A la une,
Portrait,
Témoignages
A la une,
Portrait,
Témoignages
 A la une,
Portrait,
Témoignages
A la une,
Portrait,
Témoignages
 _TopNL,
Actualité en bref,
Religion
_TopNL,
Actualité en bref,
Religion
 _TopNL,
Actualité en bref
_TopNL,
Actualité en bref
 Actualité en bref,
Art
Actualité en bref,
Art
 A la une,
Portrait,
Art
A la une,
Portrait,
Art
 Culture,
Sortir,
Littérature,
Art
Culture,
Sortir,
Littérature,
Art
 A la une,
Médecine et bioéthique,
Gastronomie
A la une,
Médecine et bioéthique,
Gastronomie
 A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Littérature,
Écritures
A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Littérature,
Écritures
 _Tribune Chrétienne,
Littérature
_Tribune Chrétienne,
Littérature








 FAIRE UN DON
FAIRE UN DON