Un tsunami d'amour : la révolution de la foi chrétienne
Depuis les premiers temps de l’Église jusqu’à nos jours, des chrétiens donnent leur vie entière – par amour pour le Christ – sans autre but que celui de venir en aide aux plus démunis.
 Vitrail dans lʼéglise Saint-Laurent, Paris. / © Shutterstock
Vitrail dans lʼéglise Saint-Laurent, Paris. / © Shutterstock
En 1947, l’actrice américaine Ava Gardner (1922-1990) visite une léproserie et dit à une religieuse : « Ma soeur, pour dix millions de dollars, je ne ferais pas une heure ce que vous faites ! » La religieuse réplique : « Pour dix millions de dollars, moi non plus, Madame. » L’explication du dévouement de tant de chrétiens tient dans les simples mots de cette soeur. S’ils ont tout quitté, ce n’est pas pour une récompense passagère de dix ou même cent millions de dollars, mais pour le Christ. Leur amour répond à celui de Jésus, car ils reconnaissent en chaque prochain en détresse le visage douloureux du Crucifié attendant un geste de compassion : « Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25,40).
Il a fallu une révolution, non violente mais absolue, pour substituer à la loi du plus fort le souci des faibles devenus des frères dont chacun sera redevable devant Dieu. Cela sans se détourner de personne, serait-ce du persécuteur, car la loi du pardon et de l’amour prime, ce qui frappa de stupeur les païens et les conduisit à la conversion. « Voyez comme ils s’aiment ! », disait-on des premières communautés chrétiennes qui mettaient en place une solidarité fraternelle inédite. La mise en commun volontaire des biens des fidèles, l’assistance aux veuves, orphelins, malades, pauvres, infirmes, prisonniers, qui dépasse vite les limites de l’Église, étonnent, car nul jamais ne s’en est préoccupé.
LE TRÉSOR DE L’ÉGLISE
Saint Laurent, bras droit du pape Sixte II et archidiacre, ne ment pas quand, arrêté en 258 et sommé de « livrer le trésor de l’Église », il rassemble les miséreux et dit : « Voici le trésor de l’Église. » À la même époque, l’archevêque de Carthage, Cyprien, liquide sa fortune pour racheter les captifs enlevés par les Berbères, chrétiens ou non, une attitude que Ambroise de Milan, son imitateur, explique un siècle après : « Pitié pour la misère d’autrui, désir de la soulager dans la mesure et même au-delà de nos forces. » En Orient où la persécution sévit, les persécuteurs voient stupéfiés leurs victimes sortir au grand jour pour soigner les malades quand la peste s’abat sur leurs villes, enterrer les morts, recueillir les enfants, et changent d’opinion sur ces gens tenus responsables de tous les maux. En 362, Julien l’Apostat reconnaît en cette charité la cause du triomphe des « Galiléens » : « Ce qui a contribué à leur développement, c’est leur humanité envers l’étranger, leur prévenance envers tous. […] Il serait honteux, quand ces athées nourrissent, en sus de leurs pauvres, nos mendiants, de montrer nos miséreux privés des secours que nous leur devons. » Ces secours, jamais le paganisme n’a songé à les donner, sa charité contrefera celle des chrétiens…
Depuis l’édit de Milan, en 313, par lequel Constantin a donné droit de cité au christianisme, l’Église, libre d’agir, a élargi les oeuvres initiées dans la clandestinité : secours alimentaires, prise en charge des orphelins, hôpitaux (le premier étant fondé à Rome par sainte Fabiola), hospices pour vieillards, asiles pour pèlerins, rachat des prisonniers, assistance aux réfugiés de guerre. Tout cela à la charge de l’Église. C’est elle qui, quand la crise économique et migratoire paralyse l’administration impériale aux IVe et Ve siècles, grâce aux évêques, supplée un pouvoir démissionnaire quand il aggrave la misère au lieu de la soulager. Martin, archevêque de Tours, en est le symbole, lui qui, non baptisé, jeune officier bouleversé par la misère ambiante, se dépouille de tout pour la soulager et, parvenu aux plus hautes fonctions ecclésiastiques, n’aura de cesse de pratiquer la charité, embrassant les lépreux, vêtant ceux qui sont nus de ses propres habits. Son exemple nourrit pour des siècles la charité de ces monastères qu’il a introduits en Gaule.
UNE CHARITÉ INÉPUISABLE ET ORGANISÉE
L’abbaye de Saint-Riquier (Somme) assure chaque jour 500 repas aux pauvres ; à Rome, le futur pape Grégoire le Grand se prive pour nourrir chaque midi douze indigents. Même aux pires heures de ces époques sombres, quand l’État s’écroule et que la papauté ne vaut guère mieux, les monastères demeurent fidèles aux oeuvres de miséricorde. Lorsque, après l’an mil, ordre, justice et paix refleurissent en Occident, c’est tous azimuts que l’Église se dévoue, dans la certitude que « chacun est responsable de tous », que le bien commun passe par la mise en pratique d’une charité inépuisable, y compris en des domaines en apparence extérieurs à ses préoccupations : construction de ponts favorisant la prospérité grâce aux échanges commerciaux et sécurisant le franchissement des fleuves, refuges de montagnes à l’initiative de Bernard de Menthon, protection armée des pèlerins de Terre sainte contre les attaques musulmanes après la conquête de Jérusalem en 1099, à l’origine des ordres militaires, Chevaliers du Temple et Hospitaliers de Saint-Jean, ceux-là ajoutant à leur mission de gendarmerie l’organisation de l’hôpital dont ils tirent leur nom pour les pèlerins malades et blessés.
Entre les XIe et XIIIe siècles se multiplient les fondations, parfois très spécialisées ou répondant à des nécessités locales : Antonins en Dauphiné pour soigner les victimes du mal des ardents, ordre du Saint-Esprit pour les enfants trouvés, ordre de Saint-Lazare, fondé à Jérusalem par des chevaliers atterrés du sort des lépreux, Croisiers qui, lors des guerres contre les Albigeois, parcourent le Midi afin de soulager la misère des populations victimes du conflit, tandis que les Frères prêcheurs, fondés en 1216 par Dominique, exercent envers ces gens la charité, spirituelle, en les ramenant à la foi catholique.
Toutes les villes se dotent de maisons-Dieu assurant soins médicaux, prise en charge des vieillards, sans-abris, orphelins. À Paris, Saint Louis fonde l’Hôtel-Dieu et les Quinze-Vingts, conçus pour abriter 80 croisés aveugles, initiant l’implication du pouvoir royal dans l’action caritative jusque-là demeurée exclusivement d’Église. En 1204, un prêtre, Foulques de Neuilly, fonde une maison pour prostituées repenties. D’autres se préoccupent des chrétiens captifs en terre d’Islam. Trinitaires et Mercédaires collectent des fonds afin de racheter ces prisonniers, s’entremettant avec les autorités musulmanes pour les libérer, allant parfois jusqu’à prendre la place d’un esclave. D’autres oeuvres assistent les condamnés à mort.
DES FIGURES INCONTOURNABLES
Réforme, guerres de religion, conflits entre princes catholiques et protestants détruisent en partie ces oeuvres mais, en Espagne et en Italie, épargnées par la crise, de nouvelles congrégations apparaissent, se donnant pour mission, selon le mot du patriarche de Venise Jérôme Émilien, de lutter « contre la misère universelle ». Saint Jean de Dieu multiplie les hôpitaux dans la péninsule ibérique ; l’archevêque de Milan, Charles Borromée, alors que la peste ravage la ville, donne en personne soins médicaux et secours spirituels aux malades. Ancien soldat, Camille de Lellis fonde les Camilliens qui se dévouent dans les hôpitaux ou sur les champs de bataille, et inspireront la Croix-Rouge. Les Jésuites, partis à la conquête de l’Extrême-Orient, puis du Canada, les prêtres des Missions étrangères de Paris au XVIIe siècle font oeuvre de miséricorde spirituelle en portant l’Évangile aux peuples qui n’ont jamais entendu parler du Christ. Au risque du martyre. Philippe Néri renonce à les rejoindre quand le Pape lui assure que ses « Indes sont à Rome » et qu’il doit oeuvrer à détourner du péché une jeunesse près de se perdre.
C’est en France qu’apparaît au XVIIe siècle, avec Vincent de Paul, l’incarnation de la charité chrétienne. La fondation des prêtres des Missions, ou Lazaristes, en 1625, répond à la nécessité de rechristianiser le pays, grâce à une nouvelle évangélisation poursuivie en formant un clergé pieux et compétent. La fondation des Dames de la Charité, avec Louise de Marillac, et des Filles de la Charité assure des secours de terrain, l’assistance quotidienne aux démunis, aux malades et aux vieillards, la prise en charge des enfants abandonnés. La compassion de Monsieur Vincent s’étend aux forçats, jusqu’à prendre au banc de nage la place d’un galérien épuisé. Devenu une sorte de ministre des affaires sociales, celui que l’on nomme la « conscience du royaume » fait toucher du doigt aux Grands l’universelle misère et les incite à agir, provoquant une vague d’engagements aristocratiques dans les bonnes oeuvres. Certaines, très spécifiques, sont touchantes, telle l’oeuvre des Petits Ramoneurs de l’abbé de Sousi, qui protège les enfants savoyards des dangers auxquels ils sont exposés.
UN COUP D’ARRÊT FUNESTE
L’esprit philosophique prend ombrage de cette mainmise cléricale sur l’assistance publique. La philanthropie, charité qui ne s’exerce plus dans le but de servir le Christ en ses pauvres, veut prouver que l’État peut assurer la tâche. On se paie de mots, tandis qu’à Marseille, en 1720, Mgr de Belsunce assiste les pestiférés, ce dont se gardent les autorités civiles ; d’autres évêques créent caisses d’allocations chômage, assurances, ateliers de dentelles pour fournir du travail aux femmes, remédient aux disettes, tel Mgr de La Marche qui impose aux paysans de Bretagne la culture de la pomme de terre.
Il ne restera rien de tout cela en France avec la confiscation, dès 1791, des biens du clergé, qui met l’Église dans l’incapacité d’assumer son immense besogne d’assistance publique et d’éducation. Ni la République révolutionnaire ni Napoléon ne la remplaceront, laissant le pays dans une misère que nul ne soulage plus. La France de 1802 est un champ de ruines où tout est à refaire. Pourtant, avant même que la paix religieuse soit assurée, certains commencent à reconstruire, telle Jeanne Antide Thouret, ancienne Fille de la Charité qui, sa congrégation tardant à se refonder, en crée une autre, vouée aux mêmes objectifs de secours et d’éducation.
UN RENOUVEAU AUX XVIIIe ET XIXe SIÈCLES
La reprise des oeuvres d’Église, à partir de 1830, connaît une explosion d’une telle vitalité qu’il est impossible de tout évoquer. On espère ainsi faire de l’action caritative un levier pour reconquérir des populations déchristianisées hostiles à l’Église. Exemplaires en ce domaine : soeur Rosalie Rendu, Fille de la Charité, dans le quartier Mouffetard ; Pauline Jaricot à Lyon ; Jeanne Jugan en Bretagne, humble domestique qui se met au service des vieillards abandonnés ; le père Lataste, fondateur des Dominicaines de Béthanie vouées à la réinsertion des prisonnières ; le père Planchat, camarade de Frédéric Ozanam, religieux de Saint- Vincent-de-Paul, fusillé par les Communards. Hors de France, Anne-Marie Javouhey libère les esclaves ; le père Laval, à l’île Maurice, prône l’égalité entre Noirs et Blancs. Citons encore tous ceux et celles qui aident jeunes travailleurs, domestiques, migrants, handicapés, forains, prisonniers, etc. L’Italie donne, à Turin, deux immenses apôtres de la charité : Jean Bosco, dont l’oeuvre éducative arrache la jeunesse à la rue, et Joseph-Benoît Cottolengo, fondateur de la « petite maison de la divine Providence », qui se donne pour objectif de secourir toutes les misères qui frappent à sa porte, jusqu’à bâtir une cité de la charité aux dimensions colossales, et ce, sans un sou.
Le XXe siècle voit encore fleurir des héros de la charité : le père Damien, le polonais frère Albert, don Orione, les Dames du Calvaire, Daniel Brottier, Padre Pio. Et tant d’autres... Pour conclure, relisons les mots de saint Paul : « Si je n’ai pas la charité, je ne suis rien. »
Anne Bernet
Retour à l'accueil

L’Église célèbre le quatre-centième anniversaire de la basilique Saint-Pierre

Un victoire des défenseurs des jeunes Pakistanaises

Au Porto Rico, une nouvelle loi reconnaît l’enfant à naître comme être humain

Myanmar : un prêtre saute sur une mine

Le miracle de l’épée dans la pierre
En 1180, après une vision de l’archange…
Jésus n'a rien écrit : voici pourquoi ! / l'idolâtrie des mots
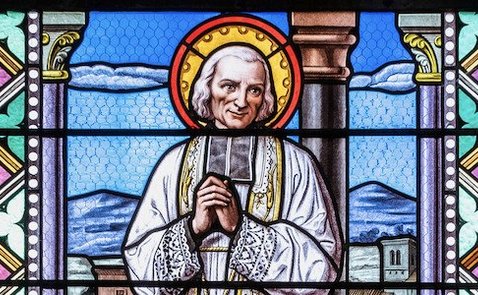
Jean-Marie Vianney, un prêtre de son temps
Avant d’être un saint, Jean-Marie…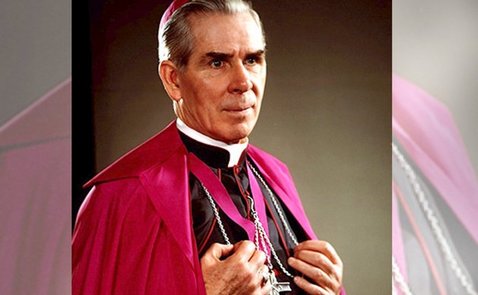

 _Tribune Chrétienne,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
Conversions
 _Tribune Chrétienne,
Portrait,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
Portrait,
Conversions
 _Tribune Chrétienne,
Portrait,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
Portrait,
Conversions
 _Tribune Chrétienne,
Miracles,
Guérisons
_Tribune Chrétienne,
Miracles,
Guérisons
 _Tribune Chrétienne,
Témoignages,
Guérisons
_Tribune Chrétienne,
Témoignages,
Guérisons
 _Tribune Chrétienne,
Miracles,
Guérisons
_Tribune Chrétienne,
Miracles,
Guérisons
 A la une,
Miracles,
Histoires providentielles
A la une,
Miracles,
Histoires providentielles
 A la une,
Témoignages,
Histoires providentielles
A la une,
Témoignages,
Histoires providentielles
 A la une,
Histoires providentielles
A la une,
Histoires providentielles
 A la une,
Ils ont vu la vierge
A la une,
Ils ont vu la vierge
 A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Ils ont vu la vierge
A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Ils ont vu la vierge
 _Tribune Chrétienne,
Ils ont vu la vierge
_Tribune Chrétienne,
Ils ont vu la vierge
 A la une,
Le saint du jour
A la une,
Le saint du jour
 A la une,
Grands entretiens
A la une,
Grands entretiens
 Actualité en bref,
Sortir,
Religion
Actualité en bref,
Sortir,
Religion
 A la une,
Sortir,
Grands reportages
A la une,
Sortir,
Grands reportages
 _Tribune Chrétienne,
Sortir,
Patrimoine
_Tribune Chrétienne,
Sortir,
Patrimoine
 _Tribune Chrétienne,
Patrimoine,
Littérature
_Tribune Chrétienne,
Patrimoine,
Littérature
 A la une,
Patrimoine
A la une,
Patrimoine
 Actualité en bref,
Patrimoine
Actualité en bref,
Patrimoine
 Actualité en bref,
Écritures
Actualité en bref,
Écritures
 A la une,
Histoire,
Écritures
A la une,
Histoire,
Écritures
 A la une,
Histoire,
Écritures
A la une,
Histoire,
Écritures
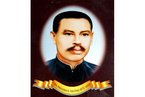 Actualité en bref,
Le saint du jour,
Églises
Actualité en bref,
Le saint du jour,
Églises
 Actualité en bref,
Églises
Actualité en bref,
Églises
 _TopNL,
Actualité en bref,
Religion,
Églises
_TopNL,
Actualité en bref,
Religion,
Églises
 A la une,
Patrimoine,
Grands reportages,
Histoires providentielles
A la une,
Patrimoine,
Grands reportages,
Histoires providentielles
 A la une,
Grands reportages,
Ils ont vu la vierge
A la une,
Grands reportages,
Ils ont vu la vierge
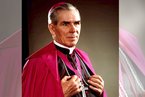 _Tribune Chrétienne,
Le saint du jour
_Tribune Chrétienne,
Le saint du jour
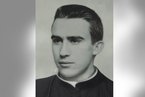 _Tribune Chrétienne,
Miracles
_Tribune Chrétienne,
Miracles
 _Tribune Chrétienne,
Actualité en bref,
Débats
_Tribune Chrétienne,
Actualité en bref,
Débats
 _Tribune Chrétienne,
Religion
_Tribune Chrétienne,
Religion
 Actualité en bref,
Société
Actualité en bref,
Société
 Actualité en bref,
Société,
Sciences
Actualité en bref,
Société,
Sciences
 Actualité en bref,
Société
Actualité en bref,
Société
 _Tribune Chrétienne,
Critiques,
Débats
_Tribune Chrétienne,
Critiques,
Débats
 _TopNL,
Actualité en bref,
Sortir,
Critiques
_TopNL,
Actualité en bref,
Sortir,
Critiques
 _Tribune Chrétienne,
Sciences,
Critiques,
Débats,
Miracles
_Tribune Chrétienne,
Sciences,
Critiques,
Débats,
Miracles
 A la une,
Éditoriaux,
Églises
A la une,
Éditoriaux,
Églises
 A la une,
Éditoriaux,
Religion
A la une,
Éditoriaux,
Religion
 A la une,
Éditoriaux,
Le saint du jour
A la une,
Éditoriaux,
Le saint du jour
 A la une,
Grands entretiens,
Témoignages
A la une,
Grands entretiens,
Témoignages
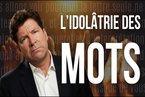 Vidéo
Vidéo
 Vidéo
Vidéo
 Vidéo
Vidéo
 Actualité en bref,
Environnement
Actualité en bref,
Environnement
 Actualité en bref,
Environnement
Actualité en bref,
Environnement
 A la une,
Environnement,
Méditation
A la une,
Environnement,
Méditation
 Actualité en bref,
Histoire
Actualité en bref,
Histoire
 _Tribune Chrétienne,
Histoire
_Tribune Chrétienne,
Histoire
 _TopNL,
Actualité en bref,
Médecine et bioéthique
_TopNL,
Actualité en bref,
Médecine et bioéthique
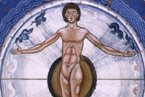 A la une,
Médecine et bioéthique,
Guérisons
A la une,
Médecine et bioéthique,
Guérisons
 _Tribune Chrétienne,
Médecine et bioéthique,
Patrimoine,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
Médecine et bioéthique,
Patrimoine,
Conversions
 A la une,
Méditation
A la une,
Méditation
 A la une,
Méditation
A la une,
Méditation
 A la une,
Méditation,
Témoignages
A la une,
Méditation,
Témoignages
 _TopNL,
Actualité en bref,
Sciences
_TopNL,
Actualité en bref,
Sciences
 Actualité en bref,
Technologies
Actualité en bref,
Technologies
 _Tribune Chrétienne,
Technologies
_Tribune Chrétienne,
Technologies
 _TopNL,
Actualité en bref,
Culture
_TopNL,
Actualité en bref,
Culture
 _Tribune Chrétienne,
L'habit ne fait pas le moine,
Portrait,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
L'habit ne fait pas le moine,
Portrait,
Conversions
 A la une,
L'habit ne fait pas le moine
A la une,
L'habit ne fait pas le moine
 A la une,
Les 5 raisons de croire de...
A la une,
Les 5 raisons de croire de...
 A la une,
Les 5 raisons de croire de...
A la une,
Les 5 raisons de croire de...
 A la une,
Les 5 raisons de croire de...
A la une,
Les 5 raisons de croire de...
 A la une,
Portrait,
Témoignages
A la une,
Portrait,
Témoignages
 A la une,
Portrait,
Témoignages
A la une,
Portrait,
Témoignages
 _TopNL,
Actualité en bref
_TopNL,
Actualité en bref
 _TopNL,
Actualité en bref,
Société
_TopNL,
Actualité en bref,
Société
 Actualité en bref,
Art
Actualité en bref,
Art
 A la une,
Portrait,
Art
A la une,
Portrait,
Art
 Culture,
Sortir,
Littérature,
Art
Culture,
Sortir,
Littérature,
Art
 A la une,
Médecine et bioéthique,
Gastronomie
A la une,
Médecine et bioéthique,
Gastronomie
 A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Littérature,
Écritures
A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Littérature,
Écritures
 _Tribune Chrétienne,
Littérature
_Tribune Chrétienne,
Littérature








 FAIRE UN DON
FAIRE UN DON