En Indonésie, une classe de catéchisme attaquée
 © CC0 pexels
© CC0 pexels
Dimanche 27 juillet, à Koto Tangah, dans la banlieue de Padang, à l’ouest de Sumatra, un groupe d’extrémistes musulmans a fait irruption dans un lieu privé transformé en lieu de culte par la communauté protestante locale. Quand les assaillants, armés de bâtons, de pierres et de couteaux, ont investi la maison, des dizaines d’enfants assistaient à un cours de catéchèse. Ils ont molesté les assistants, blessé deux enfants, et détruit les objets à caractère religieux, le mobilier et les fenêtres.
Le maire de Fadly Amran, à l’Ouest de Padang, a déploré les faits, mais en les relativisant, parlant d’une simple « incompréhension » entre voisins. Il ajoutait que le bâtiment attaqué n’était pas formellement une église, mais une maison privée utilisée par les chrétiens pour leur éducation religieuse.
Mais le responsable de la communauté, le pasteur Fu Kwet Khiong, a exprimé son inquiétude devant cet évènement, qui s’inscrit selon lui dans un contexte croissant d’intolérance religieuse. Dans une lettre ouverte adressée au président de la République Prabowo Subianto, il a écrit : « Quand des enfants sont blessés durant un temps de prière, ce n’est pas juste une maison qui est attaquée, c’est la conscience de la nation. » Dans la même missive, il demande que les responsables de l’attaque de dimanche soient arrêtés. Il s’inquiète également de voir que la « tolérance religieuse » affichée par l’administration indonésienne s’apparente plus à de la rhétorique qu’à une réelle volonté politique.
Dipa Arif, collaborateur de la commission Justice et Paix, s’inquiète d’une dérive qu’il qualifie de « pakistanaise » de son pays natal. Il rappelle que la Constitution indonésienne repose sur le Pancasila, une doctrine qui reconnaît et protège six grandes religions, dont le christianisme. Or, la multiplication des incidents antichrétiens remet en cause ce pluralisme affiché. Ainsi, l’Institut Setara a recensé plus de 3 000 violations à la liberté de religion et de croyance entre 2014 et 2024. « Derrière ces chiffres, ce sont des églises fermées, des fidèles intimidés, des fêtes religieuses perturbées, des groupes minoritaires interdits d’enregistrement ou de culte », rappelle Dipa Arif.
Il a vu durant ces deux dernières décennies la société indonésienne se transformer, le conformisme religieux se généraliser. « L’idée même qu’un chrétien puisse ouvrir un lieu de culte dans une banlieue majoritairement musulmane est devenue problématique, non pas tant en raison de la loi, mais parce que le "bon voisinage" exige désormais l’homogénéité », dénonce-t-il.
Or, les gouvernements successifs, ambigus et passifs, ne se montrent pas à la hauteur de cette menace. Dans le cas de l’attaque de Padang, l’administration n’a pas condamné clairement les violences. « Le silence de l’État, en matière de protection des minorités religieuses, est devenu une forme de complicité tacite », s’alarme-t-il. Il craint que l’archipel ne finisse par connaître le destin du Pakistan. La Constitution, démocratique et ouverte, est perpétuellement contournée ou instrumentalisée par les groupes religieux les plus revendicatifs et les plus susceptibles de faire usage de la violence.
(Sources : Asianews 29/7/2025 et blog Mediapart 29/7/2025)
Retour à l'accueil

Un jeune Américain distribue 64 000 chapelets en Afrique

L’Avent à Gaza


Philippines : l’Église au côté des manifestants
La vie de Jeanne d'Arc


Marie, un pilier dans notre vie
De l’Europe menacée aux rives de l’Inde,…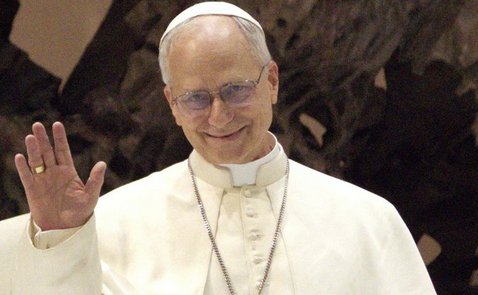
Un rencontre numérique du pape avec les jeunes à Indianapolis

Pérou-Rome. Une statue du Christ ressuscité offerte au pape


 _Tribune Chrétienne,
Portrait,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
Portrait,
Conversions
 _Tribune Chrétienne,
Portrait,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
Portrait,
Conversions
 _Tribune Chrétienne,
L'habit ne fait pas le moine,
Portrait,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
L'habit ne fait pas le moine,
Portrait,
Conversions
 _Tribune Chrétienne,
Témoignages,
Guérisons
_Tribune Chrétienne,
Témoignages,
Guérisons
 _Tribune Chrétienne,
Miracles,
Guérisons
_Tribune Chrétienne,
Miracles,
Guérisons
 Actualité en bref,
Portrait,
Guérisons
Actualité en bref,
Portrait,
Guérisons
 A la une,
Patrimoine,
Grands reportages,
Histoires providentielles
A la une,
Patrimoine,
Grands reportages,
Histoires providentielles
 _Tribune Chrétienne,
Histoires providentielles
_Tribune Chrétienne,
Histoires providentielles
 A la une,
Histoire,
Débats,
Le saint du jour,
Histoires providentielles
A la une,
Histoire,
Débats,
Le saint du jour,
Histoires providentielles
 A la une,
Ils ont vu la vierge
A la une,
Ils ont vu la vierge
 A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Ils ont vu la vierge
A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Ils ont vu la vierge
 _Tribune Chrétienne,
Ils ont vu la vierge
_Tribune Chrétienne,
Ils ont vu la vierge
 A la une,
Patrimoine
A la une,
Patrimoine
 A la une,
Grands entretiens
A la une,
Grands entretiens
 A la une,
Sortir,
Grands reportages
A la une,
Sortir,
Grands reportages
 _Tribune Chrétienne,
Sortir,
Patrimoine
_Tribune Chrétienne,
Sortir,
Patrimoine
 A la une,
Sortir
A la une,
Sortir
 Actualité en bref,
Patrimoine
Actualité en bref,
Patrimoine
 _Tribune Chrétienne,
Patrimoine
_Tribune Chrétienne,
Patrimoine
 A la une,
Histoire,
Écritures
A la une,
Histoire,
Écritures
 A la une,
Histoire,
Écritures
A la une,
Histoire,
Écritures
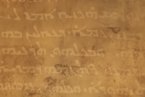 A la une,
Éditoriaux,
Écritures
A la une,
Éditoriaux,
Écritures
 _Tribune Chrétienne,
Églises
_Tribune Chrétienne,
Églises
 _Tribune Chrétienne,
Églises
_Tribune Chrétienne,
Églises
 Actualité en bref,
Églises
Actualité en bref,
Églises
 A la une,
Grands reportages,
Ils ont vu la vierge
A la une,
Grands reportages,
Ils ont vu la vierge
 _TopNL,
Actualité en bref,
Le saint du jour
_TopNL,
Actualité en bref,
Le saint du jour
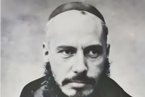 A la une,
Le saint du jour
A la une,
Le saint du jour
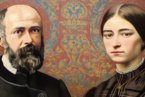 A la une,
Le saint du jour
A la une,
Le saint du jour
 _TopNL,
Actualité en bref,
Le saint du jour,
Miracles
_TopNL,
Actualité en bref,
Le saint du jour,
Miracles
 _Tribune Chrétienne,
Miracles
_Tribune Chrétienne,
Miracles
 _Tribune Chrétienne,
Société
_Tribune Chrétienne,
Société
 _Tribune Chrétienne,
Histoire
_Tribune Chrétienne,
Histoire
 _Tribune Chrétienne,
Société
_Tribune Chrétienne,
Société
 Actualité en bref,
Société
Actualité en bref,
Société
 _Tribune Chrétienne,
Critiques,
Débats
_Tribune Chrétienne,
Critiques,
Débats
 _TopNL,
Actualité en bref,
Sortir,
Critiques
_TopNL,
Actualité en bref,
Sortir,
Critiques
 _Tribune Chrétienne,
Sciences,
Critiques,
Débats,
Miracles
_Tribune Chrétienne,
Sciences,
Critiques,
Débats,
Miracles
 A la une,
Éditoriaux,
Le saint du jour
A la une,
Éditoriaux,
Le saint du jour
 A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Éditoriaux
A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Éditoriaux
 A la une,
Grands entretiens,
Témoignages
A la une,
Grands entretiens,
Témoignages
 A la une,
Patrimoine,
Grands entretiens,
Églises
A la une,
Patrimoine,
Grands entretiens,
Églises
 Vidéo
Vidéo
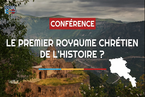 Vidéo
Vidéo
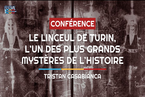 Vidéo
Vidéo
 A la une,
Environnement,
Méditation
A la une,
Environnement,
Méditation
 _Tribune Chrétienne,
Histoire,
Patrimoine
_Tribune Chrétienne,
Histoire,
Patrimoine
 _TopNL,
Actualité en bref,
Médecine et bioéthique
_TopNL,
Actualité en bref,
Médecine et bioéthique
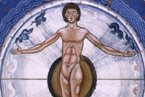 A la une,
Médecine et bioéthique,
Guérisons
A la une,
Médecine et bioéthique,
Guérisons
 _Tribune Chrétienne,
Médecine et bioéthique,
Patrimoine,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
Médecine et bioéthique,
Patrimoine,
Conversions
 A la une,
Méditation
A la une,
Méditation
 A la une,
Méditation,
Témoignages
A la une,
Méditation,
Témoignages
 A la une,
Méditation
A la une,
Méditation
 _TopNL,
Actualité en bref,
Sciences
_TopNL,
Actualité en bref,
Sciences
 _Tribune Chrétienne,
Société,
Sciences,
Églises
_Tribune Chrétienne,
Société,
Sciences,
Églises
 Actualité en bref,
Technologies
Actualité en bref,
Technologies
 _Tribune Chrétienne,
Technologies
_Tribune Chrétienne,
Technologies
 Actualité en bref
Actualité en bref
 Actualité en bref
Actualité en bref
 _TopNL,
Actualité en bref
_TopNL,
Actualité en bref
 A la une,
L'habit ne fait pas le moine
A la une,
L'habit ne fait pas le moine
 A la une,
Les 5 raisons de croire de...
A la une,
Les 5 raisons de croire de...
 A la une,
Les 5 raisons de croire de...
A la une,
Les 5 raisons de croire de...
 A la une,
Les 5 raisons de croire de...
A la une,
Les 5 raisons de croire de...
 A la une,
Portrait,
Témoignages
A la une,
Portrait,
Témoignages
 A la une,
Portrait,
Témoignages
A la une,
Portrait,
Témoignages
 _TopNL,
Actualité en bref
_TopNL,
Actualité en bref
 _TopNL,
Actualité en bref
_TopNL,
Actualité en bref
 A la une,
Portrait,
Art
A la une,
Portrait,
Art
 Culture,
Sortir,
Littérature,
Art
Culture,
Sortir,
Littérature,
Art
 A la une,
Médecine et bioéthique,
Gastronomie
A la une,
Médecine et bioéthique,
Gastronomie
 A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Littérature,
Écritures
A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Littérature,
Écritures
 _Tribune Chrétienne,
Littérature
_Tribune Chrétienne,
Littérature
 Vidéo,
Littérature,
Miracles
Vidéo,
Littérature,
Miracles








 FAIRE UN DON
FAIRE UN DON