Jeanne d'Arc, une sainte pour notre temps
Il aura fallu attendre cinq siècles pour que Jeanne, seule sainte reconnue héroïne nationale, soit portée sur les autels, le 16 mai 1920. Son martyre ressemble beaucoup à celui de Jésus-Christ, qui fut à la fois « signe de contradiction » (Lc 2,34) et d’unité.
 Jeanne, saint Michel et sainte Catherine, détail de la peinture de Hermann Anton Silke. / © Wikipédia
Jeanne, saint Michel et sainte Catherine, détail de la peinture de Hermann Anton Silke. / © Wikipédia
Jeanne naît le 6 janvier 1412. En 2012, nous avons donc fêté son sixième centenaire. À l’époque, Nicolas Sarkozy, président de la République, révélait dans une conférence à Domrémy : « Le Ciel qui s’intéresse à la politique, c’est quand même rarissime. » Lui, comme beaucoup d’autres, a été frappé par cette sainte qui ne connaissait « ni A ni B ». Elle naît, alors que des légendes circulent : « Le royaume de France a été perdu par une femme et sera sauvé par une pucelle. » La première femme est Isabeau de Bavière, la femme de Charles VI. La légende dit que la « pucelle » viendra des marches de Lorraine, et Jeanne naît entre la Champagne et la Lorraine, à Domrémy, une terre française fidèle au roi de France, Charles VII. À cette époque, le grand chancelier de l’Université de Paris est Pierre Cauchon, évêque de Beauvais et président du tribunal de Rouen. Il soutient le « honteux traité de Troyes » dans lequel Charles VI, en état de démence, déshérite son fils Charles VII et cède au roi d’Angleterre le royaume de France qui devient ainsi royaume de France et d’Angleterre. Charles VII s’est réfugié à Bourges, il n’a plus rien. Le royaume de France est divisé en deux parties : les Bourguignons, partisans de l’Angleterre, et les Armagnacs, partisans de Charles VII. Les Anglais ont mis le siège devant Orléans ; s’ils prennent la ville, ils ouvrent la vallée de la Loire puis tout le Sud.
DES VOIX SE LÈVENT POUR SAUVER LA FRANCE
À 13 ans, Jeanne commence à entendre des voix qui lui parleront jusqu’à sa mort. « Et vint cette voix environ l’heure de midi, au temps de l’été, dans le jardin de mon père », dira-t-elle à son procès. Pour l’instant, il n’est pas question de juges : la petite consacre sa virginité à Dieu et repousse toute demande en mariage. Saint Michel la prévient notamment qu’« il y a grande pitié au royaume de France ». À 17 ans, la paysanne, occasionnellement bergère, décide enfin de partir avec son oncle rencontrer le sire de Baudricourt qui est le représentant du roi à Vaucoueurs : « Il faudrait me donner un équipage pour que je puisse aller à Chinon voir le roi. » Baudricourt la prend pour une folle et dit à son oncle : « Ramenez-la chez son père avec une bonne paire de claques. » Mais Jeanne, qui a beaucoup d’allure, ne repart pas et confesse : « Je vais vous dire une chose : il y a eu une bataille que le dauphin a perdue », la bataille des Harengs. Baudricourt apprend la nouvelle officiellement deux jours plus tard et s’étonne des renseignements que détient cette fille. Alors, Jeanne insiste :
« Je viens de la part de Messire.
— Mais qui est ton Messire ?
— Dieu. »
Impressionné, Baudricourt cède et lui donne trois écuyers pour rejoindre Chinon. En mars 1429, Jeanne traverse les lignes ennemies en plein hiver. À son arrivée, Charles VII tente de la duper en plaçant un autre homme sur le trône, tandis qu’il se cache parmi 300 chevaliers. Mais elle ne s’y laisse pas prendre, s’agenouille devant lui et déclare : « Gentil Dauphin, je suis venue. » Dans la chapelle, elle lui révèle ensuite qu’elle connaît sa prière secrète prononcée lors de la bataille des Harengs. Elle l’informe : « Je suis venu te dire de par Dieu que tu es vrai héritier du royaume de France et que je te ferai sacrer à Reims. » Rassuré sur sa légitimité d’être l’héritier du royaume de France, et très impressionné, Charles VII la soumet tout de même à des examens : des femmes confirment sa virginité et des docteurs sont chargés de la juger à Poitiers et Chinon. Ils concluent qu’elle n’est ni folle ni diabolique, et qu’il n’y a en elle que du bon. Pendant que tous ces juges délibèrent, Jeanne s’entraîne à la lance et, malgré son inexpérience, elle excelle. Comment expliquer cela, sinon par une intervention surnaturelle ?
UN CHEF DE GUERRE UNIQUE ET EXCEPTIONNEL
Convaincu, le roi lui donne tout ce qu’il a : 12 000 hommes, 12 chevaux et 12 000 écus. « 12 », c’est le nombre de Jeanne. À son procès, une question lui est posée :
« Jeanne, avez-vous beaucoup d’argent ?
— J’avais 12 000 écus, mais ce n’est pas grand-chose pour mener la guerre », répond-elle, sachant que les juges de l’époque gagnaient un écu par mois.
À 17 ans, Napoléon Bonaparte est lieutenant à Valence et Jules César n’a pas encore commencé une carrière militaire ; mais Jeanne, petite paysanne de rien, devient la chef d’un corps d’armée qu’elle commande par son charisme et son autorité personnelle, sans qu’aucun titre ne lui soit donné.
Quand elle arrive à Orléans, début mai 1429, les chefs militaires, réunis en conseil d’état-major, ont décidé de ne pas intervenir, le moment est mal venu. Mais Jeanne fait preuve d’autorité : « Je suis allée à mon conseil qui est meilleur que le vôtre et j’ai décidé qu’il fallait reprendre les bastides les unes après les autres. » Notons ici que Jeanne proposera toujours la paix avant un assaut, mais cette paix sera toujours refusée. Elle prévient ses hommes : « À la première bastide, je serai blessée, mais ça ne fait rien, je repartirai. » Cela se passe ainsi. Elle se fait soigner puis repart à l’assaut : « Allez, entrez, tout est vôtre. » Derrière elle, les soldats prennent les bastides une à une, puis entrent dans Orléans. Elle y fait une entrée somptueuse, sur un cheval blanc qu’on lui apporte. Les Français viennent lui baiser les mains et lui présenter leurs enfants. Jeanne est victorieuse, nous sommes le 7 mai. Le lendemain est un dimanche. « Part-on au combat ? » lui demande-t-on. Elle répond : « Non, ils partiront d’eux-mêmes. » Pendant l’office qu’elle fait célébrer, les Anglais s’en vont, comme elle l’avait prédit.
Le roi lui demande ensuite de libérer la vallée de la Loire. Elle permet trois victoires, à Meung, à Beaugency et à Jargeau. Puis arrive la bataille de Patay, à cinq ou six kilomètres au nord d’Orléans. Lors de cette bataille, Richemont, un ancien connétable de Charles VII, revient de Bretagne avec 6 000 hommes pour se rallier à Jeanne. Un heureux hasard, car les Anglais arrivent eux-mêmes avec 6 000 hommes. D’Alençon, numéro 2 de l’armée et grand favori du roi, avait prévenu que, si Richemont revenait, il partirait. Mais, providentiellement, il n’en fait rien. Jeanne lance alors une bataille qui anéantit l’armée anglaise : c’est la revanche d’Azincourt. On compte 4 500 Anglais au tapis pour 1 Français. Cette victoire sans précédent venge toutes les défaites de la guerre de Cent Ans.
LA TRIPLE DONATION
Quelque temps plus tard, Jeanne est à table avec les chevaliers, à la droite du roi qui lui adresse ces mots : « Jeanne, je ne peux rien vous refuser. Vous m’avez tout donné. Que puis-je faire pour vous remercier ?
— Sire, donnez-moi votre royaume. »
Charles VII, embêté mais engagé, lui répond : « Jeanne, je vous donne mon royaume. » La jeune fille s’adresse alors à quatre notaires assis au bout de la table : « Notez que le roi Charles donne son royaume à Jeanne d’Arc. Voilà le plus pauvre chevalier de la terre, il n’a plus rien », dit-elle en regardant le roi, avant de rappeler les notaires et de les faire écrire : « Jeanne donne le royaume à Jésus-Christ. » Enfin, elle les rappelle une troisième fois pour qu’ils notent : « Jésus-Christ rend le royaume à Charles. »
Par cette « triple donation », Jeanne signifie à Charles VII que son royaume lui vient de Jésus et qu’il n’est que le « lieutenant du Roi des Cieux ». Sur l’étendard de Jeanne figure d’ailleurs le Christ qui tient dans ses mains le globe terrestre, ainsi que les noms « Jésus-Maria ».
En ce temps-là, Charles VII hésite à se faire sacrer à Reims ; tous les chefs militaires souhaitent plutôt repousser les Anglais jusqu’à la mer et reprendre la Normandie. Mais Jeanne est convaincue que le sacre du roi représentera plus que toutes les victoires militaires. L’épopée est compliquée : il faut traverser Troyes, Compiègne, Auxerre qui sont toutes aux mains des Anglais, comme Reims. Pourtant, Compiègne se rend très rapidement avec enthousiasme au roi de France, Auxerre aussi. À Troyes, Jeanne met le siège d’une façon si impressionnante que les bourgeois décident aussitôt de se rendre au roi de France qui amnistie tout le monde. Même chose à Reims où, le 17 juillet 1429, Charles VII est sacré. Jeanne, à genoux devant lui, pleure de joie : « Or est accompli le plaisir de Dieu qui voulait que vous fussiez sacré à Reims. »
LA CRAINTE DE LA TRAHISON
Maintenant, il faut libérer Paris. Jeanne s’en va, laissant Charles VII seul avec ses conseillers habituels. Ceux-ci l’invitent à passer un accord avec son cousin, le duc de Bourgogne, afin d’établir une trêve pour discuter d’une éventuelle paix. Jeanne avait pourtant prévenu le roi : « C’est un piège, ils demandent une trêve pour se refaire défense. Mais vous n’aurez la paix, Sire, qu’à la pointe de la lance. » Malgré cela, l’accord est passé et le roi envoie un message à Jeanne lui demandant de lever le siège de Paris. À contrecoeur, elle obéit. Elle semble avoir perdu la confiance de Charles VII qui l’envoie faire une campagne sans intérêt dans le sud de la Loire.
Plus tard, elle remonte vers le nord pour libérer Compiègne menacée par les Anglais qui veulent passer au fil de l’épée tous les hommes à partir de 7 ans. C’est en protégeant la ville qu’elle est faite prisonnière par deux capitaines bourguignons du seigneur Jean de Luxembourg. Elle avait été prévenue par ses voix dans les fossés de Melun : « Jeanne, tu vas être prisonnière, il faudra que tu le sois et il faudrait que tu voies le roi des Anglais. » Alors, elle se débarrasse de son épée aux cinq croix, afin qu’elle ne tombe pas entre les mains des Anglais. Aujourd’hui encore, l’arme est recherchée. Immédiatement, l’Université de Paris, rancunière car le traité de Troyes a été complètement balayé par l’épopée de Jeanne, écrit au roi d’Angleterre pour lui demander de racheter la prisonnière et la juger. Naît alors l’idée d’un procès inédit dans l’histoire où les vainqueurs jugent leur adversaire vaincu sans l’intervention d’un tiers.
UN PROCÈS ABJECT
Le 21 novembre 1430, les Anglais rachètent Jeanne « au prix d’un roi ». L’un de ses frères peut la voir régulièrement. Il lui rend son anneau qui lui avait été confisqué et lui en apporte un second, ressemblant au premier. Elle est si bien traitée qu’elle s’évade en enfermant son geôlier dans sa propre chambre. Vite arrêtée, elle est alors placée en haut d’une tour de trente mètres. Puisqu’elle n’a aucun moyen de descendre pour aller porter secours aux bonnes gens de Compiègne, elle décide de sauter contre l’avis de ses voix, en criant : « Jésus, Marie, sauvez-moi ! » Elle reste trois jours sans manger ni boire et sans pouvoir parler, mais n’a rien de cassé : un miracle ! Lors de son procès, les juges ne manqueront pas de le lui reprocher : « Donc, si vous avez désobéi aux voix du Ciel, vous avez fait un grand péché. » Et Jeanne de répondre : « Oui, et je m’en suis confessée. »
Le roi d’Angleterre organise le procès à Rouen, où il n’y a plus un seul homme pro-français. Il est présidé par Cauchon, évêque de Beauvais. Quand Jeanne comparait, elle est seule, face à 41 juges : des grands inquisiteurs, évêques, docteurs en théologie, en philosophie, en droit, etc., tous payés par le roi d’Angleterre. Son frère, le cardinal de Winchester, est le grand maître du procès, Cauchon n’étant que son exécuteur. Il y a quatre greffiers : deux en latin et deux en français, car Jeanne ne parle pas le latin qui est la langue officielle du tribunal.
Les quatre versions permettront de connaître presque la totalité du procès. Cauchon souhaite un grand procès à la fois militaire, religieux et politique, avec une visée internationale, afin de déconsidérer Charles VII qui aurait été assisté par une sorcière hérétique et diabolique. Dès le début, Jeanne comprend la situation avec une intelligence extraordinaire. Aussi, son tempérament très combatif lui permet de prendre la main dès la première audience. Sa stratégie est offensive, comme à la guerre, et elle esquive quand elle ne veut pas répondre : « Je ne vous répondrai pas, et vous pouvez m’écarteler à quatre chevaux, vous ne saurez pas. » Mais ses voix insistent : « Jeanne, réponds hardiment ! » ; et heureusement, sinon nous n’aurions pas eu autant d’informations sur son procès.
À L’ÉCOLE DES ANGES
Dès la deuxième séance, Jeanne obéit et répond aux questions sur saint Michel, Catherine et Marguerite qu’elle entend. Elle dit de la voix de saint Michel qu’elle est belle, douce, humble et parle le langage de France. Cocteau disait : « Le plus grand écrivain de langue française, c’est Jeanne d’Arc. » Jules Laforgue utilise une formule plus belle encore : « Elle parle un français de Christ. » Si cette jeune fille de la campagne, qui n’est jamais allée à l’école, peut parler ainsi, c’est parce qu’elle est allée durant quatre ans à l’école des anges qu’elle fréquente quotidiennement, fait unique dans l’histoire de l’Église. Ses voix ne l’ont jamais abandonnée, contrairement à ce qui a pu être dit. Même au procès, elles sont là et la rassurent : « Jeanne, ne te chaille pas, ne te fais pas de souci de ton martyre, tu seras libérée par la grande victoire. »
En parlant de saint Michel, elle confesse au juge : « Je l’ai vu comme je vous vois. » Et Cauchon de demander : « Était-il vêtu ?
— Croyez-vous que Dieu n’ait pas de quoi le vêtir ?
— Est-ce qu’il avait des cheveux ?
— Pourquoi les lui aurait-on coupés ? »
Jeanne ne répond que par des questions de façon très habile et refuse de donner à ces gens-là certains détails. Elle ne veut pas déflorer la beauté de ses apparitions.
LE MOTIF D’UNE HÉRÉSIE
Lors du procès, Jeanne finit par abjurer ses voix à la demande des juges, croyant ainsi les tromper. Elle signe une lettre qu’on refuse de lui lire, de son nom puis d’un rond et d’une croix. On comprendra plus tard que la croix signifie qu’il ne faut pas tenir compte du contenu de la lettre. Condamnée à perpétuité, au pain sec et à l’eau, elle est conduite dans une cellule au château de Rouen. Victime d’une tentative de viol, elle décide alors de remettre des habits d’hom-me, comme elle en portait à la guerre pour se protéger. Or, le Deutéronome dit : « Tu ne porteras pas un habit d’homme » (22,5). Jugée hérétique sur ce motif, elle est brûlée le 30 mai 1431, à Rouen. Quand son bourreau la croit morte d’étouffement, il éteint le feu et la montre à l’assistance, pour rassurer les Anglais qui redoutaient qu’elle s’évade comme une sorcière. Mais alors que le bourreau rallume le feu, Jeanne s’écrie six fois : « Jésus ! Jésus ! Jésus ! Jésus ! Jésus ! Jésus ! » Et une septième fois, très fort : « Jésus ! », après avoir dit : « Non, mes voix ne m’avaient pas menti. Oui, mes voix étaient de Dieu. » Elle confirme ainsi tout ce qu’elle avait déclaré lors de son procès, et avant. Son coeur, lui, refuse de brûler, au grand désarroi du bourreau : « C’est la première fois. On me dit que j’ai brûlé une sainte. Le coeur ne veut pas brûler. » Le cardinal de Winchester lui répond : « Jette tout à la Seine ! Tout, y compris toutes les cendres ! Qu’il ne reste rien ! » Et pourtant… Si le corps de la Pucelle d’Orléans disparaît, son âme pure et sainte plane encore et pour toujours sur notre pays.
LA SAINTETÉ DE JEANNE DANS LA VIE MILITAIRE
Bien que la notion de « sainte guerre » n’existe pas dans l’Église, Jeanne est le modèle des chevaliers. Elle a cette conversation avec Cauchon : « Qu’aimez-vous le mieux ? Votre épée ou votre étendard ?
— J’aimais quarante fois plus mon étendard que mon épée. Et quand je chargeais, je chargeais toujours avec mon étendard, pour éviter de tuer personne.
— Jeanne, vous dites ça, mais vous avez été dans des endroits où beaucoup d’Anglais furent tués !
— Comme vous en parlez doucement ! Ils n’avaient qu’à rentrer chez eux. »
Jeanne a toujours voulu qu’on épargne les blessés et les prisonniers. Quand un soldat ennemi est mourant, elle demande qu’on lui administre sans tarder les sacrements. Elle interdit les jurons – contraires au deuxième commandement du Décalogue – et envoie à confesse ses chefs militaires. Elle parvient aussi à purifier l’armée des viols, du pillage et d’une sexualité débridée. Chaque jour, Jeanne se confesse et pleure, car elle ne mène pas seulement une guerre contre les Anglais ou les Bourguignons, mais aussi une bataille politique au sein de son propre camp.
LA SAINTETÉ DE JEANNE EN MATIÈRE POLITIQUE
Jeanne est une très grande politicienne. D’abord, elle conforte le Dauphin dans sa propre légitimité ; ensuite, elle le fait sacrer ; enfin, elle se met à son service, alors qu’elle a un sens politique bien plus aigu que lui. Elle respecte l’ordre politique établi, car elle possède une vertu rare dans le domaine : l’humilité. On n’en mesure l’ampleur qu’à la lumière de ses qualités naturelles couplées à ses voix surnaturelles qui la mettent au service d’une personne qui, sur le plan humain, est médiocre.
LA SAINTETÉ DE JEANNE DANS LE MONDE JUDICIAIRE
Jeanne est fille de Dieu, mais elle est aussi fille de l’Église. Quand on lui demande : « Jeanne, êtes-vous fidèle à Jésus-Christ ou à l’Église ? », elle répond : « Pour moi, Jésus-Christ et l’Église, c’est tout un. » Sa formule rappelle celle de saint Paul (Ép 1,22-23), car Jeanne a une notion extrêmement forte de l’Église. Quand les juges lui disent : « La différence : il y a l’Église triomphante, l’Église du Ciel, et il y a l’Église militante qui n’existe pas, et nous, les juges de Jeanne, nous sommes les chefs de l’Église militante. Êtes-vous obéissante à l’Église militante ? », sa réponse fuse : « Oui, Messire Dieu premier servi. » C’est la con-damnation de tous les cléricalismes.
Jeanne est une sainte pour notre temps, celui des laïcs, premières victimes de notre société déchristianisée. Elle incarne pleinement cette condition, étant femme, paysanne et soldat ; mais elle est aussi sainte et surnaturelle. Son parcours nous rappelle ainsi que le surnaturel n’intervient pas pour remplacer le naturel, mais pour le soutenir dans ses efforts. Telle est la grande leçon de Jeanne.
Jacques Trémolet de Villers
Retour à l'accueil

Un pont nommé « San Diablo » fait scandale en Bolivie

Le « non » catégorique des évêques de France à l’«assistance médicale à mourir »

Le Bangladesh accueille son premier prêtre des Oraon

Israël : Les écoles chrétiennes sous pression

Grandeur et misère du sacerdoce
Qu’est-ce donc que le sacerdoce dont…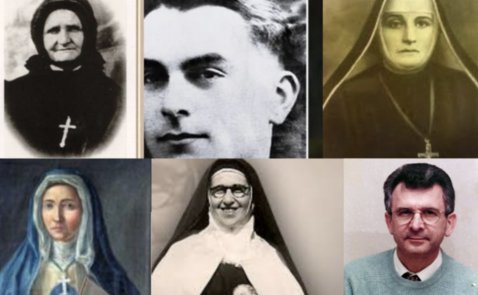
De nouveaux vénérables et un martyre officiellement reconnus par le Saint-Siège
Il ne faut pas confondre la foi et la crédulité !

La puissance du sacerdoce
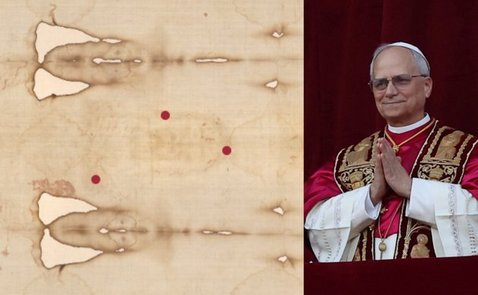

 _Tribune Chrétienne,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
Conversions
 _Tribune Chrétienne,
Portrait,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
Portrait,
Conversions
 _Tribune Chrétienne,
Portrait,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
Portrait,
Conversions
 _Tribune Chrétienne,
Témoignages,
Guérisons
_Tribune Chrétienne,
Témoignages,
Guérisons
 _Tribune Chrétienne,
Miracles,
Guérisons
_Tribune Chrétienne,
Miracles,
Guérisons
 Actualité en bref,
Portrait,
Guérisons
Actualité en bref,
Portrait,
Guérisons
 A la une,
Témoignages,
Histoires providentielles
A la une,
Témoignages,
Histoires providentielles
 A la une,
Histoires providentielles
A la une,
Histoires providentielles
 A la une,
Société,
Histoires providentielles
A la une,
Société,
Histoires providentielles
 A la une,
Ils ont vu la vierge
A la une,
Ils ont vu la vierge
 A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Ils ont vu la vierge
A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Ils ont vu la vierge
 _Tribune Chrétienne,
Ils ont vu la vierge
_Tribune Chrétienne,
Ils ont vu la vierge
 A la une,
Éditoriaux,
Églises
A la une,
Éditoriaux,
Églises
 A la une,
Éditoriaux,
Religion
A la une,
Éditoriaux,
Religion
 A la une,
Sortir,
Grands reportages
A la une,
Sortir,
Grands reportages
 _Tribune Chrétienne,
Sortir,
Patrimoine
_Tribune Chrétienne,
Sortir,
Patrimoine
 A la une,
Sortir
A la une,
Sortir
 _Tribune Chrétienne,
Patrimoine,
Littérature
_Tribune Chrétienne,
Patrimoine,
Littérature
 A la une,
Patrimoine
A la une,
Patrimoine
 Actualité en bref,
Patrimoine
Actualité en bref,
Patrimoine
 Actualité en bref,
Écritures
Actualité en bref,
Écritures
 A la une,
Histoire,
Écritures
A la une,
Histoire,
Écritures
 A la une,
Histoire,
Écritures
A la une,
Histoire,
Écritures
 Actualité en bref,
Églises
Actualité en bref,
Églises
 _TopNL,
Actualité en bref,
Églises
_TopNL,
Actualité en bref,
Églises
 A la une,
Patrimoine,
Grands reportages,
Histoires providentielles
A la une,
Patrimoine,
Grands reportages,
Histoires providentielles
 A la une,
Grands reportages,
Ils ont vu la vierge
A la une,
Grands reportages,
Ils ont vu la vierge
 _Tribune Chrétienne,
Le saint du jour
_Tribune Chrétienne,
Le saint du jour
 _Tribune Chrétienne,
Le saint du jour
_Tribune Chrétienne,
Le saint du jour
 _TopNL,
Actualité en bref,
Le saint du jour
_TopNL,
Actualité en bref,
Le saint du jour
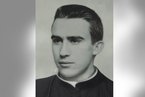 _Tribune Chrétienne,
Miracles
_Tribune Chrétienne,
Miracles
 _TopNL,
Actualité en bref,
Le saint du jour,
Miracles
_TopNL,
Actualité en bref,
Le saint du jour,
Miracles
 _TopNL,
Actualité en bref,
Société
_TopNL,
Actualité en bref,
Société
 Actualité en bref,
Société,
Religion
Actualité en bref,
Société,
Religion
 Actualité en bref,
Société
Actualité en bref,
Société
 _Tribune Chrétienne,
Critiques,
Débats
_Tribune Chrétienne,
Critiques,
Débats
 _TopNL,
Actualité en bref,
Sortir,
Critiques
_TopNL,
Actualité en bref,
Sortir,
Critiques
 _Tribune Chrétienne,
Sciences,
Critiques,
Débats,
Miracles
_Tribune Chrétienne,
Sciences,
Critiques,
Débats,
Miracles
 A la une,
Éditoriaux,
Le saint du jour
A la une,
Éditoriaux,
Le saint du jour
 A la une,
Grands entretiens,
Témoignages
A la une,
Grands entretiens,
Témoignages
 A la une,
Patrimoine,
Grands entretiens,
Églises
A la une,
Patrimoine,
Grands entretiens,
Églises
 Vidéo
Vidéo
 Vidéo
Vidéo
 Vidéo
Vidéo
 Actualité en bref,
Environnement
Actualité en bref,
Environnement
 Actualité en bref,
Environnement
Actualité en bref,
Environnement
 A la une,
Environnement,
Méditation
A la une,
Environnement,
Méditation
 Actualité en bref,
Histoire
Actualité en bref,
Histoire
 _Tribune Chrétienne,
Histoire
_Tribune Chrétienne,
Histoire
 _TopNL,
Actualité en bref,
Médecine et bioéthique
_TopNL,
Actualité en bref,
Médecine et bioéthique
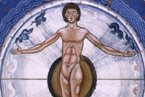 A la une,
Médecine et bioéthique,
Guérisons
A la une,
Médecine et bioéthique,
Guérisons
 _Tribune Chrétienne,
Médecine et bioéthique,
Patrimoine,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
Médecine et bioéthique,
Patrimoine,
Conversions
 A la une,
Méditation
A la une,
Méditation
 A la une,
Méditation
A la une,
Méditation
 A la une,
Méditation,
Témoignages
A la une,
Méditation,
Témoignages
 _TopNL,
Actualité en bref,
Sciences
_TopNL,
Actualité en bref,
Sciences
 _Tribune Chrétienne,
Société,
Sciences,
Églises
_Tribune Chrétienne,
Société,
Sciences,
Églises
 Actualité en bref,
Technologies
Actualité en bref,
Technologies
 _Tribune Chrétienne,
Technologies
_Tribune Chrétienne,
Technologies
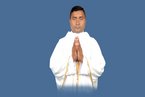 Actualité en bref,
Religion
Actualité en bref,
Religion
 _Tribune Chrétienne,
L'habit ne fait pas le moine,
Portrait,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
L'habit ne fait pas le moine,
Portrait,
Conversions
 A la une,
L'habit ne fait pas le moine
A la une,
L'habit ne fait pas le moine
 A la une,
Les 5 raisons de croire de...
A la une,
Les 5 raisons de croire de...
 A la une,
Les 5 raisons de croire de...
A la une,
Les 5 raisons de croire de...
 A la une,
Les 5 raisons de croire de...
A la une,
Les 5 raisons de croire de...
 A la une,
Portrait,
Témoignages
A la une,
Portrait,
Témoignages
 A la une,
Portrait,
Témoignages
A la une,
Portrait,
Témoignages
 _TopNL,
Actualité en bref,
Religion
_TopNL,
Actualité en bref,
Religion
 _TopNL,
Actualité en bref
_TopNL,
Actualité en bref
 Actualité en bref,
Art
Actualité en bref,
Art
 A la une,
Portrait,
Art
A la une,
Portrait,
Art
 Culture,
Sortir,
Littérature,
Art
Culture,
Sortir,
Littérature,
Art
 A la une,
Médecine et bioéthique,
Gastronomie
A la une,
Médecine et bioéthique,
Gastronomie
 A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Littérature,
Écritures
A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Littérature,
Écritures
 _Tribune Chrétienne,
Littérature
_Tribune Chrétienne,
Littérature








 FAIRE UN DON
FAIRE UN DON