Le prêtre qui découvrit les Khmers rouges
 Cartes des zones d'activités des khmers rouges en 1989-1990. / © toony, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
Cartes des zones d'activités des khmers rouges en 1989-1990. / © toony, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
« Phnom Penh libéré », titrait Le Monde le 17 avril 1975, alors que les Khmers rouges défilaient dans la capitale cambodgienne après une longue et terrible guerre civile. Parmi ceux qui voyaient défiler les nouveaux maîtres, soldats émaciés aux uniformes de fortune, se trouvait le missionnaire français François Ponchaud. Devant ces soldats qui entraient silencieusement et qui fusillaient du regard les étrangers, le prêtre déclara d’emblée à un ami : « Avec ceux-là, on ne va pas rigoler. »
Lui-même n’avait pourtant pas d’a priori excessivement négatif à l’égard de ces nouveaux conquérants. Il était dégoûté par la corruption du régime précédent et par la brutalité des interventions américaines qui lâchaient des tapis de bombes, au mépris des vies civiles. Mais, grâce à sa connaissance du Khmer, il découvrit rapidement l’ampleur de la folie des nouveaux maîtres. Etant parmi les derniers étrangers à être expulsés, il ne perdit pas tout contact avec le peuple cambodgien grâce aux réfugiés et à la radio khmère.
Le régime mis en place par Pol Pot ne cachait pas ses intentions. Les Khmers rouges vidèrent les villes et imposèrent des travaux forcés à une population qu’ils entendaient « purifier ». Ce programme délirant provoqua la mort de près de deux millions de personnes. Depuis l’étranger, le père Ponchaud tentait d’alerter la communauté internationale sur ce qui se passait, mais il rencontrait l’incrédulité d’une grande partie du monde médiatique français.
Soupçonné d’anticommunisme primaire, il récolta une vaste documentation pour appuyerses dire et écrivit « Cambodge, année zéro » (Julliard, 1977). En septembre 1978, il fut enfin auditionné par la Commission des Droits de l’Homme de l’ONU à Genève, sans résultat tangible : « Je fis l’effet d’un OVNI qui parlait de choses irréelles. » Malgré l’avalanche de documents qui démontraient la nature criminelle de leur régime, les Khmers rouges siégèrent à l’ONU jusqu’en 1989.
Aussitôt qu’il a été possible pour des étrangers de revenir au Cambodge, le père Ponchaud a repris son travail d’évangélisation du pays. Très attaché au peuple auquel il avait dédié sa vie, il a tenté de comprendre sa culture si particulière. Inquiet de voir qu’il avait peu conscience de son histoire, il publia une Brève histoire du Cambodge. « Le livre, traduit en khmer, s’arrache chez les étudiants. Ils n’ont pas de conscience historique, et guère plus de connaissances de leur géographie », expliquait-il.
Il constatait que l’annonce de l’Évangile était rendue difficile par la culture particulière de ce pays, qui ignore la notion de personne : « Moi qui vous parle, je ne suis pas un sujet. On me donne un nom parce qu’il le faut bien, pour faciliter les relations. Chacun de nous n’est qu’un faisceau d’énergies, un être sans sujet. » C’est probablement ce qui explique que, bien que les premiers missionnaires aient débarqué au XVIe siècle, il ait fallu attendre 1950 pour qu’une première vocation sacerdotale locale advienne.
En 1975, l’Église locale comptait environ 100 000 âmes. Lorsque le pays se rouvrit, en 1991, il ne restait pas plus de 3000 catholiques. Aujourd’hui ils sont 25 000 catholiques. Le père Ponchaud, décédé le 17 janvier 2025, se réjouissait de voir l’émergence d’un clergé khmer à la fin de sa vie. Mais il s’inquiétait, en même temps, de la fragilité de cette Église et de la domination du matérialisme sur un peuple fragilisé par son expérience traumatisante.
(Sources : La règle du jeu 6/02/2010 et sources personnelles)
Retour à l'accueil
Ce que Darwin n'avait pas prévu... l'analyse choc du scientifique Michael Denton
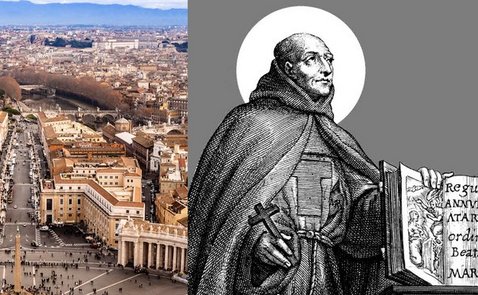
Le Français Gabriel-Maria Nicolas déclaré bienheureux par le pape Léon XIV

États-Unis : L’esprit missionnaire du père Javier Olivera Ravasi

Gaza « La guerre n’est pas finie ! »

Nigeria « La foi de notre peuple est inébranlable »

L’Église célèbre le quatre-centième anniversaire de la basilique Saint-Pierre

Un victoire des défenseurs des jeunes Pakistanaises

Au Porto Rico, une nouvelle loi reconnaît l’enfant à naître comme être humain

Myanmar : un prêtre saute sur une mine


 _Tribune Chrétienne,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
Conversions
 _Tribune Chrétienne,
Portrait,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
Portrait,
Conversions
 _Tribune Chrétienne,
Portrait,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
Portrait,
Conversions
 _Tribune Chrétienne,
Miracles,
Guérisons
_Tribune Chrétienne,
Miracles,
Guérisons
 _Tribune Chrétienne,
Témoignages,
Guérisons
_Tribune Chrétienne,
Témoignages,
Guérisons
 _Tribune Chrétienne,
Miracles,
Guérisons
_Tribune Chrétienne,
Miracles,
Guérisons
 A la une,
Miracles,
Histoires providentielles
A la une,
Miracles,
Histoires providentielles
 A la une,
Témoignages,
Histoires providentielles
A la une,
Témoignages,
Histoires providentielles
 A la une,
Histoires providentielles
A la une,
Histoires providentielles
 A la une,
Ils ont vu la vierge
A la une,
Ils ont vu la vierge
 A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Ils ont vu la vierge
A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Ils ont vu la vierge
 _Tribune Chrétienne,
Ils ont vu la vierge
_Tribune Chrétienne,
Ils ont vu la vierge
 A la une,
Le saint du jour
A la une,
Le saint du jour
 A la une,
Grands entretiens
A la une,
Grands entretiens
 Actualité en bref,
Sortir,
Religion
Actualité en bref,
Sortir,
Religion
 A la une,
Sortir,
Grands reportages
A la une,
Sortir,
Grands reportages
 _Tribune Chrétienne,
Sortir,
Patrimoine
_Tribune Chrétienne,
Sortir,
Patrimoine
 _Tribune Chrétienne,
Patrimoine,
Littérature
_Tribune Chrétienne,
Patrimoine,
Littérature
 A la une,
Patrimoine
A la une,
Patrimoine
 Actualité en bref,
Patrimoine
Actualité en bref,
Patrimoine
 Actualité en bref,
Écritures
Actualité en bref,
Écritures
 A la une,
Histoire,
Écritures
A la une,
Histoire,
Écritures
 A la une,
Histoire,
Écritures
A la une,
Histoire,
Écritures
 Actualité en bref,
Églises
Actualité en bref,
Églises
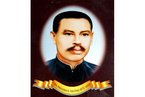 Actualité en bref,
Le saint du jour,
Églises
Actualité en bref,
Le saint du jour,
Églises
 Actualité en bref,
Églises
Actualité en bref,
Églises
 A la une,
Patrimoine,
Grands reportages,
Histoires providentielles
A la une,
Patrimoine,
Grands reportages,
Histoires providentielles
 A la une,
Grands reportages,
Ils ont vu la vierge
A la une,
Grands reportages,
Ils ont vu la vierge
 _Tribune Chrétienne,
Le saint du jour
_Tribune Chrétienne,
Le saint du jour
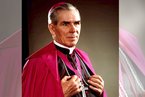 _Tribune Chrétienne,
Le saint du jour
_Tribune Chrétienne,
Le saint du jour
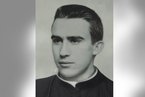 _Tribune Chrétienne,
Miracles
_Tribune Chrétienne,
Miracles
 _Tribune Chrétienne,
Actualité en bref,
Débats
_Tribune Chrétienne,
Actualité en bref,
Débats
 _TopNL,
Actualité en bref,
Société
_TopNL,
Actualité en bref,
Société
 Actualité en bref,
Société
Actualité en bref,
Société
 Actualité en bref,
Société,
Sciences
Actualité en bref,
Société,
Sciences
 _Tribune Chrétienne,
Critiques,
Débats
_Tribune Chrétienne,
Critiques,
Débats
 _TopNL,
Actualité en bref,
Sortir,
Critiques
_TopNL,
Actualité en bref,
Sortir,
Critiques
 _Tribune Chrétienne,
Sciences,
Critiques,
Débats,
Miracles
_Tribune Chrétienne,
Sciences,
Critiques,
Débats,
Miracles
 A la une,
Éditoriaux,
Églises
A la une,
Éditoriaux,
Églises
 A la une,
Éditoriaux,
Religion
A la une,
Éditoriaux,
Religion
 A la une,
Éditoriaux,
Le saint du jour
A la une,
Éditoriaux,
Le saint du jour
 A la une,
Grands entretiens,
Témoignages
A la une,
Grands entretiens,
Témoignages
 Vidéo
Vidéo
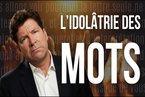 Vidéo
Vidéo
 Vidéo
Vidéo
 Actualité en bref,
Environnement
Actualité en bref,
Environnement
 Actualité en bref,
Environnement
Actualité en bref,
Environnement
 A la une,
Environnement,
Méditation
A la une,
Environnement,
Méditation
 Actualité en bref,
Histoire
Actualité en bref,
Histoire
 _Tribune Chrétienne,
Histoire
_Tribune Chrétienne,
Histoire
 _TopNL,
Actualité en bref,
Médecine et bioéthique
_TopNL,
Actualité en bref,
Médecine et bioéthique
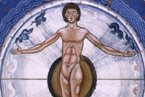 A la une,
Médecine et bioéthique,
Guérisons
A la une,
Médecine et bioéthique,
Guérisons
 _Tribune Chrétienne,
Médecine et bioéthique,
Patrimoine,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
Médecine et bioéthique,
Patrimoine,
Conversions
 A la une,
Méditation
A la une,
Méditation
 A la une,
Méditation
A la une,
Méditation
 A la une,
Méditation,
Témoignages
A la une,
Méditation,
Témoignages
 _TopNL,
Actualité en bref,
Sciences
_TopNL,
Actualité en bref,
Sciences
 Actualité en bref,
Technologies
Actualité en bref,
Technologies
 _Tribune Chrétienne,
Technologies
_Tribune Chrétienne,
Technologies
 Actualité en bref,
Religion
Actualité en bref,
Religion
 _Tribune Chrétienne,
L'habit ne fait pas le moine,
Portrait,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
L'habit ne fait pas le moine,
Portrait,
Conversions
 A la une,
L'habit ne fait pas le moine
A la une,
L'habit ne fait pas le moine
 A la une,
Les 5 raisons de croire de...
A la une,
Les 5 raisons de croire de...
 A la une,
Les 5 raisons de croire de...
A la une,
Les 5 raisons de croire de...
 A la une,
Les 5 raisons de croire de...
A la une,
Les 5 raisons de croire de...
 A la une,
Portrait,
Témoignages
A la une,
Portrait,
Témoignages
 A la une,
Portrait,
Témoignages
A la une,
Portrait,
Témoignages
 _TopNL,
Actualité en bref,
Culture
_TopNL,
Actualité en bref,
Culture
 _TopNL,
Actualité en bref
_TopNL,
Actualité en bref
 Actualité en bref,
Art
Actualité en bref,
Art
 A la une,
Portrait,
Art
A la une,
Portrait,
Art
 Culture,
Sortir,
Littérature,
Art
Culture,
Sortir,
Littérature,
Art
 A la une,
Médecine et bioéthique,
Gastronomie
A la une,
Médecine et bioéthique,
Gastronomie
 A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Littérature,
Écritures
A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Littérature,
Écritures
 _Tribune Chrétienne,
Littérature
_Tribune Chrétienne,
Littérature








 FAIRE UN DON
FAIRE UN DON