Trump-Zelensky, l’improbable tête à tête aux funérailles du pape François
 Les présidents américain Donald Trump (à gauche) et ukrainien Volodymyr Zelensky lors des funérailles du pape François, le 26 avril 2025 au Vatican. / © Service de presse de la présidence ukrainienne, AFP.
Les présidents américain Donald Trump (à gauche) et ukrainien Volodymyr Zelensky lors des funérailles du pape François, le 26 avril 2025 au Vatican. / © Service de presse de la présidence ukrainienne, AFP.
L’image insolite a déjà fait couler beaucoup d’encre : deux chaises métalliques isolées dans l’immensité de la basilique Saint-Pierre. Donald Trump et Volodymyr Zelensky font leur « disputatio » au cœur du Siège de Pierre endeuillé. Viendrait-on désormais des plus hautes instances des nations vers la Chaire de Saint Pierre au-dessus de laquelle rayonne puissamment la Colombe de l’Esprit Saint, pour trouver l’inspiration nécessaire au retour de la paix ? L’Église à la périphérie de la politique ou la politique à la périphérie de l’Église ? Volodymyr Zelensky espère que cette « bonne réunion […] pourrait devenir historique si des résultats communs sont atteints ». Quoi qu’il advienne, le pape François aurait sûrement vu dans cette scène un clin d’œil providentiel.
Il n’y a encore pas si longtemps, une telle rencontre eût été impossible. « Pendant la majeure partie de son histoire, le gouvernement américain n'a envoyé personne aux funérailles de l'évêque de Rome », rappelle Matthew McDonald, journaliste au National Catholic Register. L’opposition anticatholique protestante voyait d’un mauvais œil d’éventuelles relations diplomatiques entre la Maison Blanche et le Saint-Siège.
Que s’est-il donc passé depuis pour que l’actuel président, issu du protestantisme presbytérien, déclare : « Melania et moi irons aux funérailles du pape François, à Rome. Nous avons hâte d'y être ! » L’empressement peut étonner, car le conflit entre Donald et François était ouvert notamment sur l’immigration et le changement climatique. Pourtant, les drapeaux américains avaient été mis en berne pour la mort du Pape.
Michael Moreland, professeur de droit et de religion à l'université Villanova (Pennsylvanie), explique que « du point de vue américain, le catholicisme jusqu'aux années 50 et 60 et l'élection de John Kennedy comme président, était une religion ésotérique, et les catholiques n'étaient pas vraiment acceptés dans le courant dominant. » Entre 1867 et 1984, les deux États n’entretenaient pas de relations diplomatiques.
Le premier président américain catholique, John F. Kennedy, avait différé son déplacement à Rome pour ne pas assister au couronnement du pape Paul VI en 1963. Au lieu de l’agenouillement et du baiser de l'anneau du pape, encore de mise à l’époque, il s’en était tenu à la simple poignée de main en guise de salutation officielle.
Selon le père James Garneau, historien catholique américain, Benoît XV, au début XXème, a travaillé à l’ouverture de relations diplomatiques entre les deux États, sans grands résultats immédiats. Cependant, Wilson rencontra, presque malgré lui, le souverain pontife en 1919. En 1939, Roosevelt envoya un « représentant personnel » auprès de Pie XII. En 1958, à la mort de Pie XII, Eisenhower envoya plusieurs représentants. En 1963, Kennedy dépêche son vice-président Lindon Johnson aux obsèques de Jean XXIII. Devenu président, Johnson tiendra à rencontrer Paul VI venu au siège de l’ONU, à New-York. Mais toujours pas de relations diplomatiques. En 1978, Jimmy Carter envoya aussi son vice-président aux obsèques de Paul VI puis de Jean-Paul Ier, la même année ainsi que la Première Dame pour celles de Paul VI. Il a fallu attendre 1984 pour que Reagan ouvre avec Jean-Paul II des relations diplomatiques officielles et envoie un ambassadeur près le Saint-Siège. C’est le fruit de leur lutte commune contre le communisme. Peu à peu le peuple américain évolua. « Je pense que ce changement reflète le profond changement d’attitude des Américains envers l’Église catholique », avait commenté l’essayiste catholique George Weigel.
Autres temps, autres mœurs, aujourd’hui le président des États-Unis non seulement se rend à Rome pour assister aux funérailles du Souverain Pontife, mais profite de l’occasion pour reprendre avec le président ukrainien, dans la nef de Saint-Pierre, un dialogue qui avait été houleux deux mois plus tôt à la Maison blanche.
(Source : ncregister.com)
Retour à l'accueil
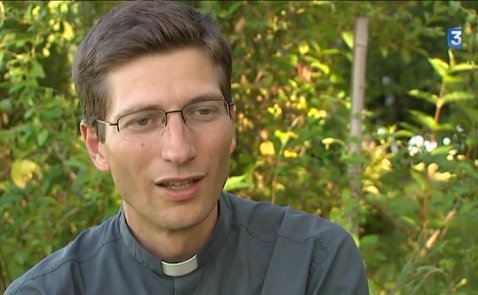
L’humilité au service de la grâce
À Ars, sur les pas du saint curé, le…
Des chrétiens ukrainiens sous surveillance russe

États-Unis. La servante de Dieu Adèle Brice, en route vers la canonisation

Syrie : « Il est temps de tourner la page »

Nullité de mariage : le jugement doit unir vérité et charité, rappelle Léon XIV

La beauté et la conversion de saint Augustin | Yves-Marie Lequin
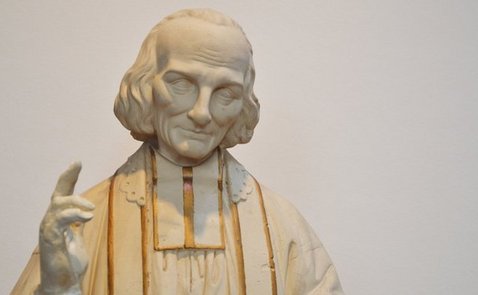
Les secrets du Curé d’Ars
De la pauvreté à la sainteté, le Curé…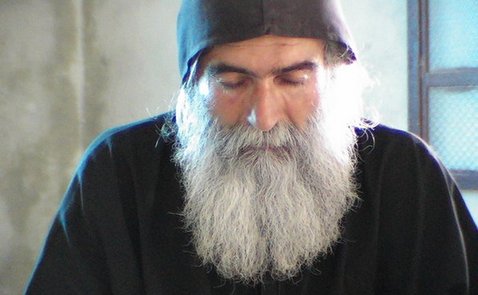

 _Tribune Chrétienne,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
Conversions
 _Tribune Chrétienne,
Portrait,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
Portrait,
Conversions
 _Tribune Chrétienne,
Portrait,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
Portrait,
Conversions
 _Tribune Chrétienne,
Miracles,
Guérisons
_Tribune Chrétienne,
Miracles,
Guérisons
 _Tribune Chrétienne,
Témoignages,
Guérisons
_Tribune Chrétienne,
Témoignages,
Guérisons
 _Tribune Chrétienne,
Miracles,
Guérisons
_Tribune Chrétienne,
Miracles,
Guérisons
 A la une,
Témoignages,
Histoires providentielles
A la une,
Témoignages,
Histoires providentielles
 A la une,
Histoires providentielles
A la une,
Histoires providentielles
 A la une,
Société,
Histoires providentielles
A la une,
Société,
Histoires providentielles
 A la une,
Ils ont vu la vierge
A la une,
Ils ont vu la vierge
 A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Ils ont vu la vierge
A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Ils ont vu la vierge
 _Tribune Chrétienne,
Ils ont vu la vierge
_Tribune Chrétienne,
Ils ont vu la vierge
 A la une,
Grands entretiens
A la une,
Grands entretiens
 A la une
A la une
 A la une,
Éditoriaux,
Églises
A la une,
Éditoriaux,
Églises
 A la une,
Sortir,
Grands reportages
A la une,
Sortir,
Grands reportages
 _Tribune Chrétienne,
Sortir,
Patrimoine
_Tribune Chrétienne,
Sortir,
Patrimoine
 A la une,
Sortir
A la une,
Sortir
 _Tribune Chrétienne,
Patrimoine,
Littérature
_Tribune Chrétienne,
Patrimoine,
Littérature
 A la une,
Patrimoine
A la une,
Patrimoine
 Actualité en bref,
Patrimoine
Actualité en bref,
Patrimoine
 Actualité en bref,
Écritures
Actualité en bref,
Écritures
 A la une,
Histoire,
Écritures
A la une,
Histoire,
Écritures
 A la une,
Histoire,
Écritures
A la une,
Histoire,
Écritures
 Actualité en bref,
Églises
Actualité en bref,
Églises
 _TopNL,
Actualité en bref,
Religion,
Églises
_TopNL,
Actualité en bref,
Religion,
Églises
 A la une,
Patrimoine,
Grands reportages,
Histoires providentielles
A la une,
Patrimoine,
Grands reportages,
Histoires providentielles
 A la une,
Grands reportages,
Ils ont vu la vierge
A la une,
Grands reportages,
Ils ont vu la vierge
 _Tribune Chrétienne,
Le saint du jour
_Tribune Chrétienne,
Le saint du jour
 _Tribune Chrétienne,
Le saint du jour
_Tribune Chrétienne,
Le saint du jour
 _TopNL,
Actualité en bref,
Le saint du jour
_TopNL,
Actualité en bref,
Le saint du jour
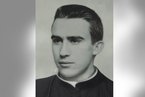 _Tribune Chrétienne,
Miracles
_Tribune Chrétienne,
Miracles
 _Tribune Chrétienne,
Religion
_Tribune Chrétienne,
Religion
 _TopNL,
Actualité en bref,
Société
_TopNL,
Actualité en bref,
Société
 Actualité en bref,
Société
Actualité en bref,
Société
 Actualité en bref,
Société
Actualité en bref,
Société
 _Tribune Chrétienne,
Critiques,
Débats
_Tribune Chrétienne,
Critiques,
Débats
 _TopNL,
Actualité en bref,
Sortir,
Critiques
_TopNL,
Actualité en bref,
Sortir,
Critiques
 _Tribune Chrétienne,
Sciences,
Critiques,
Débats,
Miracles
_Tribune Chrétienne,
Sciences,
Critiques,
Débats,
Miracles
 A la une,
Éditoriaux,
Religion
A la une,
Éditoriaux,
Religion
 A la une,
Éditoriaux,
Le saint du jour
A la une,
Éditoriaux,
Le saint du jour
 A la une,
Grands entretiens,
Témoignages
A la une,
Grands entretiens,
Témoignages
 Vidéo
Vidéo
 Vidéo
Vidéo
 Vidéo
Vidéo
 Actualité en bref,
Environnement
Actualité en bref,
Environnement
 Actualité en bref,
Environnement
Actualité en bref,
Environnement
 A la une,
Environnement,
Méditation
A la une,
Environnement,
Méditation
 Actualité en bref,
Histoire
Actualité en bref,
Histoire
 _Tribune Chrétienne,
Histoire
_Tribune Chrétienne,
Histoire
 _TopNL,
Actualité en bref,
Médecine et bioéthique
_TopNL,
Actualité en bref,
Médecine et bioéthique
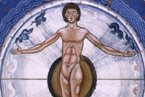 A la une,
Médecine et bioéthique,
Guérisons
A la une,
Médecine et bioéthique,
Guérisons
 _Tribune Chrétienne,
Médecine et bioéthique,
Patrimoine,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
Médecine et bioéthique,
Patrimoine,
Conversions
 A la une,
Méditation
A la une,
Méditation
 A la une,
Méditation
A la une,
Méditation
 A la une,
Méditation,
Témoignages
A la une,
Méditation,
Témoignages
 _TopNL,
Actualité en bref,
Sciences
_TopNL,
Actualité en bref,
Sciences
 _Tribune Chrétienne,
Société,
Sciences,
Églises
_Tribune Chrétienne,
Société,
Sciences,
Églises
 Actualité en bref,
Technologies
Actualité en bref,
Technologies
 _Tribune Chrétienne,
Technologies
_Tribune Chrétienne,
Technologies
 Actualité en bref,
Religion
Actualité en bref,
Religion
 Actualité en bref,
Témoignages
Actualité en bref,
Témoignages
 _Tribune Chrétienne,
L'habit ne fait pas le moine,
Portrait,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
L'habit ne fait pas le moine,
Portrait,
Conversions
 A la une,
L'habit ne fait pas le moine
A la une,
L'habit ne fait pas le moine
 A la une,
Les 5 raisons de croire de...
A la une,
Les 5 raisons de croire de...
 A la une,
Les 5 raisons de croire de...
A la une,
Les 5 raisons de croire de...
 A la une,
Les 5 raisons de croire de...
A la une,
Les 5 raisons de croire de...
 A la une,
Portrait,
Témoignages
A la une,
Portrait,
Témoignages
 A la une,
Portrait,
Témoignages
A la une,
Portrait,
Témoignages
 _TopNL,
Actualité en bref,
Société
_TopNL,
Actualité en bref,
Société
 Actualité en bref,
Art
Actualité en bref,
Art
 A la une,
Portrait,
Art
A la une,
Portrait,
Art
 Culture,
Sortir,
Littérature,
Art
Culture,
Sortir,
Littérature,
Art
 A la une,
Médecine et bioéthique,
Gastronomie
A la une,
Médecine et bioéthique,
Gastronomie
 A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Littérature,
Écritures
A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Littérature,
Écritures
 _Tribune Chrétienne,
Littérature
_Tribune Chrétienne,
Littérature








 FAIRE UN DON
FAIRE UN DON