Les églises prises pour cibles en Nouvelle Calédonie
 Saint-Louis au Mont-Dore, Nouvelle Calédonie / © Torbenbrinker, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Saint-Louis au Mont-Dore, Nouvelle Calédonie / © Torbenbrinker, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Plusieurs églises ont été incendiées par des indépendantistes kanaks depuis le 10 juillet 2024. Parmi elles, Saint-Louis au Mont-Dore, dont les murs blancs et les toits rouges dominaient l’agglomération de Nouméa, est symbolique à plus d’un titre. Elle avait été bâtie en 1860 et la Mission catholique qui lui était associée avait participé à l’évangélisation du peuple kanak. « Symboliquement, c’est grave, car la Mission de Saint-Louis est le début du développement de la Mission catholique », proteste Mgr Ghislain de Rasilly, l’évêque émérite de Wallis-et-Futuna.
La situation a dégénéré à partir de la mort, le 10 juillet, de Rock Victorin Wamytan. Cet indépendantiste kanak a été tué par un gendarme. Le procureur de la République a assuré qu’il s’agissait d’un tir de riposte, effectué par le gendarme alors que son adversaire avait ouvert le feu avec une arme de guerre. Le Monde rapporte que Rock Victorin Wamytan dit « banane » avait plusieurs vols de véhicules à main armé à son passif. De plus, le 7 juillet, il aurait chassé les sœurs des Petites Filles de Marie, pris possession du presbytère en l'absence du prêtre, et tiré sur les gendarmes depuis le premier étage, accompagné d’une dizaine d’individus.
Le fait que cet homme et ses acolytes s’en soient pris à une institution religieuse est une nouveauté, assure Eric Descheemaeker, professeur à l'Université de Melbourne (Australie) : « Jamais dans l’histoire de l’indépendantisme kanak (…) une quelconque haine anticatholique [n’avait été] mise en avant. » Le professeur rappelle que l’une des plus grandes figures de de l’indépendantisme kanak, Jean-Marie Tjibaou, était d’ailleurs un prêtre catholique, réduit sur sa demande à l’état laïc afin de poursuivre son engagement politique. Par ailleurs, l’Église a historiquement soutenu la population kanake, notamment grâce à l’éducation scolaire. L’école républicaine ayant été longtemps réservée aux européens, ce sont les écoles catholiques qui ont pris en charge la population autochtone.
Par ailleurs, s’agissant du combat indépendantiste, il parait contre-productif de s’en prendre aux Églises d’Océanie qui ont plutôt été des relais d’influence efficaces pour la cause décoloniale. Dans une perspective plus large, les indépendantistes qui voudraient rallier les communautés polynésiennes à leur cause devraient savoir que beaucoup d’entre-elles se distinguent par une foi catholique solide, qui fait partie intégrante de leur identité.
Eric Descheemaeker voit dans ces actes contre-productifs une « influence étrangère » évidente. « On n’invente pas des éléments de discours aussi nouveaux, et aussi radicalement absurdes eu égard à sa propre histoire, en quelques jours », assure-t-il. Il rappelle qu’une délégation calédonienne a fait le déplacement jusqu’à Bakou, en Azerbaïdjan, pour constituer un « Front international de libération des colonies françaises ». Auprès des Azerbaïdjanais, qui soutiennent les indépendantistes les plus extrémistes, la délégation a probablement été incitée à reprendre le discours qui assimile évangélisation et colonisation, conclut le professeur.
(Sources : Revue Conflits 20/7/2024 et Vatican News 16/7/2024)
Retour à l'accueil

À Loreto, un sanctuaire marial unique au monde
Loreto, petit village de la région des…
Trump-Zelensky, l’improbable tête à tête aux funérailles du pape François

Prochaine ouverture du conclave au Vatican

Offensive islamique en Indonésie

Requiem amazonien pour le pape François
L'argument cosmologique du commencement : une preuve de l'existence de Dieu

Jeanne, une sainte sur tous les fronts
Hautement populaire de son vivant…
« Les anges existent et ils nous accompagnent déjà vers l’éternité »

Le vice-président américain JD Vance, dernier homme d’État reçu par le pape François


 _TopNL,
Actualité en bref,
Conversions
_TopNL,
Actualité en bref,
Conversions
 _Tribune Chrétienne,
Médecine et bioéthique,
Patrimoine,
Conversions
_Tribune Chrétienne,
Médecine et bioéthique,
Patrimoine,
Conversions
 Vidéo,
Conversions
Vidéo,
Conversions
 Actualité en bref,
Portrait,
Guérisons
Actualité en bref,
Portrait,
Guérisons
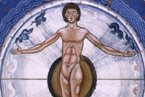 A la une,
Médecine et bioéthique,
Guérisons
A la une,
Médecine et bioéthique,
Guérisons
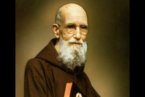 _Tribune Chrétienne,
Le saint du jour,
Guérisons
_Tribune Chrétienne,
Le saint du jour,
Guérisons
 A la une,
Sciences,
Miracles,
Histoires providentielles,
Conversions
A la une,
Sciences,
Miracles,
Histoires providentielles,
Conversions
 A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Ils ont vu la vierge
A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Ils ont vu la vierge
 _TopNL,
Actualité en bref,
Ils ont vu la vierge
_TopNL,
Actualité en bref,
Ils ont vu la vierge
 A la une,
Miracles,
Ils ont vu la vierge
A la une,
Miracles,
Ils ont vu la vierge
 A la une,
Histoire,
Patrimoine
A la une,
Histoire,
Patrimoine
 A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Éditoriaux
A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Éditoriaux
 _TopNL,
Actualité en bref,
Sortir,
Critiques
_TopNL,
Actualité en bref,
Sortir,
Critiques
 _TopNL,
A la une,
Société,
Histoire,
Culture,
Sortir
_TopNL,
A la une,
Société,
Histoire,
Culture,
Sortir
 A la une,
Sortir,
Patrimoine
A la une,
Sortir,
Patrimoine
 A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Littérature,
Écritures
A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Littérature,
Écritures
 A la une,
Écritures
A la une,
Écritures
 Grands entretiens,
Écritures
Grands entretiens,
Écritures
 _TopNL,
Actualité en bref,
Églises
_TopNL,
Actualité en bref,
Églises
 _TopNL,
Actualité en bref,
Églises
_TopNL,
Actualité en bref,
Églises
 Actualité en bref,
Églises
Actualité en bref,
Églises
 A la une,
Grands reportages,
Ils ont vu la vierge
A la une,
Grands reportages,
Ils ont vu la vierge
 A la une,
Grands reportages
A la une,
Grands reportages
 A la une,
Histoire,
Grands reportages,
Ils ont vu la vierge
A la une,
Histoire,
Grands reportages,
Ils ont vu la vierge
 A la une,
Histoire,
Portrait,
Le saint du jour
A la une,
Histoire,
Portrait,
Le saint du jour
 _Tribune Chrétienne,
Le saint du jour
_Tribune Chrétienne,
Le saint du jour
 Vidéo,
Littérature,
Miracles
Vidéo,
Littérature,
Miracles
 _Tribune Chrétienne,
Sciences,
Critiques,
Débats,
Miracles
_Tribune Chrétienne,
Sciences,
Critiques,
Débats,
Miracles
 A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Grands entretiens,
Miracles
A la une,
Histoire,
Patrimoine,
Grands entretiens,
Miracles
 _Tribune Chrétienne,
Religion,
Témoignages
_Tribune Chrétienne,
Religion,
Témoignages
 _Tribune Chrétienne,
Débats,
Religion
_Tribune Chrétienne,
Débats,
Religion
 _Tribune Chrétienne,
Société
_Tribune Chrétienne,
Société
 _Tribune Chrétienne,
Société,
Culture,
Débats
_Tribune Chrétienne,
Société,
Culture,
Débats
 _Tribune Chrétienne,
Société,
Culture
_Tribune Chrétienne,
Société,
Culture
 _Tribune Chrétienne,
Société,
Critiques
_Tribune Chrétienne,
Société,
Critiques
 A la une,
Éditoriaux
A la une,
Éditoriaux
 A la une,
Patrimoine,
Éditoriaux
A la une,
Patrimoine,
Éditoriaux
 A la une,
Grands entretiens,
Témoignages
A la une,
Grands entretiens,
Témoignages
 A la une,
Patrimoine,
Grands entretiens,
Églises
A la une,
Patrimoine,
Grands entretiens,
Églises
 A la une,
Patrimoine,
Grands entretiens
A la une,
Patrimoine,
Grands entretiens
 Vidéo
Vidéo
 Vidéo
Vidéo
 Vidéo
Vidéo
 A la une,
Environnement,
Méditation
A la une,
Environnement,
Méditation
 A la une,
Sciences,
Médecine et bioéthique,
Grands entretiens
A la une,
Sciences,
Médecine et bioéthique,
Grands entretiens
 A la une,
Méditation,
Témoignages
A la une,
Méditation,
Témoignages
 A la une,
Méditation
A la une,
Méditation
 _TopNL,
Actualité en bref,
Sciences
_TopNL,
Actualité en bref,
Sciences
 _Tribune Chrétienne,
Société,
Sciences,
Églises
_Tribune Chrétienne,
Société,
Sciences,
Églises
 _Tribune Chrétienne,
Technologies
_Tribune Chrétienne,
Technologies
 Actualité en bref
Actualité en bref
 _TopNL,
Actualité en bref
_TopNL,
Actualité en bref
 Actualité en bref
Actualité en bref
 A la une,
L'habit ne fait pas le moine
A la une,
L'habit ne fait pas le moine
 People,
Les 5 raisons de croire de...
People,
Les 5 raisons de croire de...
 _Tribune Chrétienne,
Portrait,
Patrimoine
_Tribune Chrétienne,
Portrait,
Patrimoine
 _TopNL,
Actualité en bref
_TopNL,
Actualité en bref
 A la une,
Portrait,
Art
A la une,
Portrait,
Art
 Culture,
Sortir,
Littérature,
Art
Culture,
Sortir,
Littérature,
Art
 A la une,
Médecine et bioéthique,
Gastronomie
A la une,
Médecine et bioéthique,
Gastronomie
 _Tribune Chrétienne,
Littérature
_Tribune Chrétienne,
Littérature








 FAIRE UN DON
FAIRE UN DON